|

Pablo de Santis est né à Buenos Aires en 1963. Il écrit ses premières œuvres - des contes de science fiction et d'horreur - à l'âge précoce de 11 ans. Titulaire d'une maîtrise de Lettres, il est tout à la fois écrivain, journaliste et scénariste de bande dessinée. Il a publié plusieurs romans pour adolescents, auprès desquels il a un succès considérable. Il dirige une collection de littérature pour la jeunesse dans une maison d'édition argentine.
Collaborateur, puis rédacteur en chef de la revue Fierro, éditeur pour la jeunesse, critique et scénariste de bandes dessinées (Max Cachimba), romancier (premier : El palacio de la noche, 1987).
Son œuvre pour adultes débute avec la publication de deux romans en 1998 : Filosofía y letras et La Traducción. Ce dernier a été finaliste du Prix Planeta Argentine 1997. Par la suite, El Teatro de la memoria est publié en 2000. Son roman le plus récent, El Calígrafo de Voltaire, est paru en 2001 en Argentine.
En 2007 il a reçu le premier prix Planeta Casa de las Americas, à Bogota, Colombie pour son roman El enigma de Paris (Le cercle de douze)
Pablo De Santis est né à Buenos Aires le 27 février 1963. Il possède une maitrise en lettres délivré par l’Université Nationale de Buenos Aires. Son premier roman, « El palacio de la noche », a été publié en 1987. Après il a publié entre autres « Desde el ojo del pez », « La sombra del dinosaurio », « Pesadilla para hackers », « El último espia », « Lucas Lenz y el Museo del Universo », « Enciclopedia en la hoguera », « Las plantas carnivoras » et « Páginas mezcladas », qui était surtout destiné au public jeune. « La traducción » a été finaliste du Premio Planeta en 1997. Après ce succès, cet argentin a continué a publié et son dernier roman, « El enigma de Paris » a reçu en 2007 le Premio Planeta-CASAMERICA de roman ibéro américain.
Il a été scénariste et chef de rédaction de la revue « Fierro ». Il a également publié des livres de critique sur la bande dessinée. A la télévision, il a été l’auteur des textes des émissions « El otro lado » et « El visitante », ainsi que scénariste de la mini-série « Bajamar, la costa del silencio ». Actuellement, il dirige les collections La movida et Obsesiones, qui sont destinées à des lecteurs adolescents ainsi que Enedé qui réunit les classiques de la fameuse « historieta » argentine.
Bibliographie :
El palacio de la noche
Desde el ojo del pez
La sombra del dinosaurio
Pesadilla para hackers
El último espia
Lucas Lenz y el Museo del Universo (1992)
Enciclopedia en la hoguera (1995)
Las plantas carnivoras
Páginas mezcladas (1998)
La traducción (1998) VF : La traduction
Filosofía y Letras (1999)
El teatro de la memoria (2000) VF : Le théâtre de la mémoire
El caligrafo de Voltaire (2001) VF : Le calligraphe de Voltaire
El inventor de juegos (2003)
La sexta lampara (2005)
El enigma de Paris (2007)
Editions :
VO : « El enigma de Paris » de Pablo DE SANTIS
Ediciones Planeta (282 pages) Precio : 21€
Prix Librairie Espagnole (7, rue Littré 75006 Paris, Tél.: 01-43-54-56-26):N.C.
source : http://pinguinoweb.free.fr
Crimes et jardins
Pablo de Santis (Auteur), François Gaudry (Traduction)
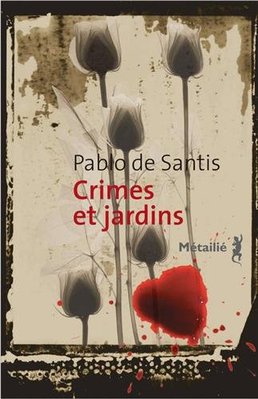
- Broché: 261 pages
- Editeur : Editions Métailié (6 mars 2014)
- Buenos Aires, 1894. Le jeune Sigmundo Salvatrio a repris l'agence Craig après la mort de son mentor. Il affronte ici sa première affaire. La découverte d'un cadavre avec une statuette de Narcisse oriente l'enquête vers un groupe de philosophes des jardins aux agissements pour le moins bizarres.
Quelle est la place des jardins dans la culture ? Doivent-ils être la réplique du Jardin d'Éden avant la Chute ou bien ordonnés et géométriques à l'image de ceux de l'Atlantide ? Relèvent-ils de l'ésotérisme ? Ces théories peuvent-elles avoir inspiré une série de crimes ? Un psychiatre, un antiquaire, un poète, un chasseur et un riche entrepreneur, membres du mystérieux club Sub Rosa, consacrent leurs soirées à débattre de ces questions. Au centre de l'intrigue le roi du sel, menacé de ruine, et sa fille Irène, belle, folle et visionnaire. Les crimes brutaux succèdent aux débats mythologiques et le jeune Salvatrio, chassé de ce qu'il croyait être son foyer et logé à "l'hôtel des suicidés", doit affronter le machiavélique Castelvetia tout en enquêtant sur son énigme personnelle : Mme Craig et son jardin d'hiver.
Dans ce roman aux sentiers qui bifurquent, Pablo de Santis se révèle héritier de la meilleure veine fantastique argentine, maître des atmosphères étranges et des ambiances occultes, et son enquêteur ingénu et maladroit mène avec maestria une enquête qui laisse toujours sa part au hasard.
-
La soif primordiale
Pablo de Santis (auteur) François Gaudry (traducteur)
titre original: Los Anticuarios

- Broché
- Editeur : Editions Métailié (23 février 2012)
- Collection : BB HISPANIQ.
Dans la Buenos Aires des années 50, à l’ombre de la dictature, Santiago, un jeune provincial réparateur de machines à écrire, se retrouve, par hasard, responsable de la rubrique ésotérique du journal où il travaille et informateur du ministère de l’Occulte, organisme officiel chargé de la recherche sur ces thèmes et les vérités qu’ils recouvrent.
Malgré son scepticisme à l’égard du surnaturel, Santiago assiste à une rencontre de spécialistes des superstitions, y est témoin d’un meurtre et mis en contact avec “les antiquaires”, des êtres extraordinaires qui vivent dans la pénombre entourés d’objets anciens, vendent de vieux livres et sont la proie d’une soif primordiale, celle du sang.
Le hasard ou le destin, mais surtout un étrange amour, puissant et troublant, amènera Santiago à ne plus résister à cette soif et il devra alors chercher à survivre, peut-être pour l’éternité, dans un monde hostile.
Extrait de La soif primordiale - Pablo de SANTIS
I
LE MONDE DE L'OCCULTE
Chez moi, il n'y avait pas de livres. J'ai vu un livre pour la première fois le jour où j'ai brisé une vitre de l'école avec un lance-pierre formé d'une branche en Y, de deux lanières de chambre à air et d'un morceau de cuir. Nous étions en train de jouer dans la cour en terre, pendant une chaude récréation qui commençait à s'éterniser, et je venais de découvrir en moi, urgent et fatidique, le désir d'impressionner une nouvelle élève. C'était la fille du médecin, elle avait des cheveux blonds qui lui arrivaient à mi-dos, des lunettes rondes qui grossissaient démesurément ses yeux bleus et une boîte de trente-six crayons de couleur fabriqués en Suisse. J'aurais pu lui demander quelque chose, ou lui emprunter un crayon, mais j'eus alors l'impression que le monde des mots était pauvre et insuffisant et que je n'arriverais à rien avec des formules de politesse, des plaisanteries ou des insultes. À cet instant, je vis la grive dans la cour, étourdie de soif ou de chaleur. Je cherchai dans mes poches un caillou rond et visai l'oiseau qui venait de s'envoler maladroitement vers le toit de l'école. Au lieu de s'intéresser à l'oiseau réel, le caillou chercha son reflet tremblant dans le carreau de la fenêtre. Le fracas de la vitre éteignit tous les sons autour de moi, sauf le murmure métallique des peupliers, que je trouve maintenant lugubre et prémonitoire. La nouvelle élève se baissa pour ramasser un débris de verre et le regarda comme si dans sa vie elle n'avait jamais rien vu de semblable. Indifférent à la surprise des autres, j'observai sa main qui tenait le bout de verre et découvris la minuscule coupure et la goutte de sang. Personne n'y prêtait attention, car tout le monde avait les yeux braqués sur moi, attendant de voir comment j'allais m'y prendre pour cacher le lance-pierre, me fondre dans le groupe et simuler l'innocence. Mais je ne fis rien de tel, je continuais de regarder cette goutte de sang sur la main de la fillette, qui semblait l'offrir comme quelque chose rapporté de très loin avec d'énormes précautions. Le silence dura jusqu'à ce que mon nom soit prononcé : “Élève Lebrón !”, puis, comme pour lever le moindre doute sur mon identité : “Élève Santiago Lebrón !”, et ces mots rendirent ses bruits au monde. On entendit de nouveau les chansons des fillettes qui sautaient à la corde, des onomatopées de pirates à l'abordage et des détonations de colts. Mais je ne pus revenir aussi vite à la routine ; on me confisqua le lance-pierre qui se retrouva dans ce musée invisible où maîtresses et directrices d'école entreposent depuis des lustres ce genre d'objets, et pour me punir on m'envoya à la bibliothèque municipale. C'était une maison aux murs chaulés, solitaire et humide, qui remplissait la double fonction de bibliothèque et de cellule d'isolement. La punition se prolongea une semaine et, par ennui, je me mis à fouiner sur les étagères, parmi les tomes de vieilles encyclopédies et quelques romans d'aventures. C'est ainsi que j'ai commencé à lire. Mon attention fut au début attirée par de nombreux livres qui n'étaient pas massicotés. Il ne me vint pas à l'idée que l'on devait soi-même couper les pages, je me disais que ces livres étaient ainsi et qu'il était impératif de les lire avec difficulté, comme un espion. Des livres destinés à garder un secret.
La nouvelle élève resta quelques mois encore puis partit, aussi discrètement qu'elle était arrivée : sa mère s'ennuyait au village et avait obligé son mari à chercher un meilleur poste. Comme à Los Álamos les nouveautés n'étaient pas légion, pendant plus d'un an on continua de parler d'elle et de ses crayons de couleur. Mais personne n'évoqua jamais la goutte de sang, qui n'intéressait que moi. Dans la vie réelle il y avait aussi des choses qui restaient cachées entre des pages non massicotées.
Cela fait maintenant de nombreuses années que je suis propriétaire d'une librairie de livres d'occasion. Elle se trouve dans le passage La Piedad ; la rue est étroite, ce qui évite d'être accablé par le soleil. Je me sens protégé par les livres qui forment des parois irrégulières, les murailles de mon château. D'ailleurs, à l'époque de l'ancien propriétaire (Carlos Calisser, alias le Français) la librairie s'appelait La Forteresse. Au fond, il y a mon bureau et un escalier par lequel je monte dans ma chambre. J'ai un sofa, une table de nuit en bois ciré et un guéridon en bronze. Je n'ai pas besoin de plus. La chambre n'a pas de fenêtre. Malgré mon âge, je n'ai besoin ni de lunettes ni de la lumière du jour pour lire.
J'ai appris qu'une librairie doit se protéger autant de l'ordre que du désordre. Si elle est trop chaotique et que le client ne peut s'y orienter seul, il s'en va. Si l'ordre est excessif, le client a l'impression de connaître la librairie de fond en comble et que rien ne le surprendra. Et il s'en va également. Il faut songer que les librairies de livres d'occasion n'existent que pour les lecteurs qui détestent poser des questions : ils veulent trouver par eux-mêmes. De plus, ils ne savent jamais ce qu'ils cherchent ; ils ne le savent que lorsqu'ils l'ont trouvé. Dans La Forteresse, je laisse coexister des principes de classification contradictoires : ainsi, un mur est réservé à l'ordre alphabétique, un autre aux livres rares, un troisième aux récits de voyage ou aux classiques. Mon rayon favori est celui des œuvres dépareillées : un tome II des Démons, de Dostoïevski, Albertine disparue, de Proust, l'appendice du dictionnaire étymologique grec de Lidell-Scott, le tome III de Cœur de jade, de Salvador de Madariaga… Ces livres, qui sont des rossignols, provoquent pourtant de temps en temps un petit miracle quand se présente un client à qui il manquait précisément ce tome-là. C'est agréable de voir que parfois, dans le puzzle du monde, une pièce finit par trouver sa place.
Dans La Forteresse, il n'y a pas que des livres. J'ai quatre machines à écrire hors d'usage qui attendent que je m'arme de patience pour les réparer, et cette Hermès sur laquelle j'écris, bien graissée et brillante, dont je me sers parfois pour rédiger de la correspondance commerciale. Par les temps qui courent, il est difficile de trouver des rubans, sans parler de pièces détachées, mais si cette machine fonctionne encore, c'est parce que je dois être un des rares en ville à connaître l'art perdu de les réparer.
Olivetti, Corona, Underwood, Hermès, Continental, Remington, Royal. J'ai encore l'impression d'entendre le crépitement des machines la nuit.
À l'âge de vingt ans, j'ai quitté mon village, Los Álamos, et je suis venu vivre en ville. J'arrivai avec une valise en cuir, déjà vieille à cette époque, que mon père – qui n'était jamais sorti du pays – avait couverte d'étiquettes d'hôtels d'Europe et de grands paquebots. Je dénichai une chambre dans une pension de la rue Sarandí, en face du cinéma Gloria, et entrepris de chercher le domicile de l'oncle Emilio, l'unique frère de mon père. Je mis deux semaines à le trouver : il possédait un atelier de réparation de machines à écrire et à calculer dans la rue Venezuela. Je franchis le seuil, qui était ouvert, et cheminai entre des machines démontées et des boîtes de sardines transformées en cendriers. Une lumière laiteuse entrait par une claire-voie : au fond de l'atelier se tenait l'oncle Emilio, bien rasé, peigné à la gomina, une petite médaille d'or sur son maillot de corps troué. Il serrait une vis et tirait sur sa cigarette ; autre tour de vis et une bouffée de plus. Je me présentai et il me regarda sans surprise, comme s'il recevait tous les jours un neveu différent.
-Donc, toi tu es Santiaguito. Ton père, qu'il repose en paix, était un fou. Et maintenant dis-moi : qu'est-ce que tu sais faire ?
Je ne pouvais pas lui dire qu'à Los Álamos je passais mes après-midi à la bibliothèque municipale, au milieu d'encyclopédies auxquelles il manquait des tomes et de romans de Pierre Loti, d'Eugène Sue, d'Emilio Salgari, de Rafael Sabatini et de Jules Verne. Parfois m'accompagnait Marcial Ferrat, mon vieux copain, qui empruntait et rendait toujours le même livre : Guerre et Paix. Il n'a jamais pu le terminer. J'avais attendu en vain l'arrivée d'un nouveau livre, mais ce furent cinquante exemplaires du même. Les Barbelés de la mémoire, les souvenirs d'un fermier de la région. Quel intérêt pouvaient avoir pour moi ces souvenirs qui ne faisaient que reproduire ce qui m'entourait ? Des vaches, encore des vaches, toujours des vaches. Moi, j'avais envie qu'on me parle de ce que je ne voyais pas, de ce qui était loin. (Quand on est jeune, on confond l'étranger avec l'avenir.) Si je lui avais fait part de mes lectures, mon oncle m'aurait pris pour un efféminé. Je lui ai dit que je m'y connaissais un peu en moteurs et que peut-être les machines à écrire n'étaient pas très différentes.
-Parfait. Les bons mécaniciens travaillent à l'oreille. J'en ai connu un qui ne mettait pas de salopette : chemise blanche, col dur et jamais la moindre tache. Avec ces machines il faut aussi travailler à l'oreille. Écoute. Tac, tac, tac.
Les jours suivants, il me fit écouter des machines aux défectuosités diverses. Il parcourait l'atelier, en touchait une ici, une autre plus loin, en signalant de grandes différences, alors qu'elles me semblaient toutes pareilles. Il commença à me confier des tâches simples. Il se réservait les travaux les plus délicats, me laissant démonter et remonter les machines, ou chercher des pièces dans un meuble à multiples petits tiroirs. Outre mon travail de technicien, je faisais aussi office de coursier : j'allais chercher les machines à réparer dans les bureaux du centre et je les rapportais. C'était le journal Últimas noticias qui faisait le plus appel à ses services. Il m'arrivait d'y passer trois fois par jour.
-Sur les machines des journaux, tu vas voir que le X est toujours sale. Les secrétaires ne s'en servent jamais, alors que les journalistes en abusent pour rayer.
Je commençais à avoir mal au dos à force de porter ces machines. Mon oncle me payait très peu, mais au moins j'apprenais un métier. Et il était content d'avoir un disciple :
-Le plus difficile, c'est quand une machine tombe par terre. Rien n'est peut-être brisé, mais la machine entière commence à dysfonctionner, comme si elle avait perdu son âme.
Parfois il m'invitait à manger dans une taverne, près de son atelier. Il regardait le menu, comme s'il hésitait à choisir, et disait :
-Le goût est dans la variété.
Mais il commandait toujours le même plat : bifteck-salade et fromage italien avec confiture de patates douces.
Il aimait aussi parler de mon père. J'avais des souvenirs flous ; il les précisait, les corrigeait, les colorait. J'aurais préféré que certains restent vagues et en noir et blanc. La seule chose que je savais de mon père c'était qu'il avait été voyageur de commerce et qu'il était mort dans un accident de voiture en 1935, sur la route de Catamarca.
-Ton père était un fou, Santiaguito. Il conduisait comme s'il avait le diable aux trousses. Il était doué pour la vente. Il pouvait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et la clé de son succès c'était qu'il ne cherchait jamais à convaincre. Il laissait les gens se convaincre tout seuls. En 1928, à Trenque Lauquen, on l'a arrêté parce qu'il vendait une eau miraculeuse censée permettre la longévité. Au début, il parlait sans conviction, laissant les gens dans le doute. Les flacons ne se vendaient pas. Mais à la fin de son petit speech, il laissait tomber, mine de rien, son livret militaire. Le livret passait de main en main : il y était écrit qu'il avait soixante-dix ans. Les gens s'émerveillaient de sa peau sans rides, de ses cheveux noirs, brillants, sans le moindre fil blanc. Bien sûr, il n'avait en réalité que trente-quatre ans. Alors les flacons s'envolaient, eau miraculeuse pour tous !
-Et on a fini par l'arrêter…
-Ce sont des choses qui arrivent. Malgré ce petit souci avec la justice, il gardait un bon souvenir de l'eau miraculeuse. Il en buvait un flacon par semaine. Mais l'eau miraculeuse ne pouvait rien contre la vitesse, les chemins défoncés, les virages serrés, la pluie.
Un après-midi, mon oncle tint à aller lui-même chercher une machine au journal. Quand il revint à l'atelier, il la posa sur la table, au milieu des étaux et des tournevis, et me tendit une carte de visite.
-Demain, tu iras voir ce type. C'est le chef de maintenance du journal. Ils cherchent un technicien qui soit présent de dix heures à six heures au journal, et n'en bouge pas. Et qui, en passant, change les joints des robinets, les ampoules, ce genre de bricoles.
Je nettoyai mes mains graisseuses avant de prendre la carte. Mais j'avais beau me les laver, il n'y avait pas moyen de les débarrasser complètement de la graisse : elle restait entre les doigts, sous les ongles, sur les lignes de la paume.
-Cela ne veut pas dire que tu dois oublier ton oncle. Passe me voir de temps en temps.
Je le lui promis. Et dès que je serais payé, c'était moi qui allais l'inviter au restaurant du coin. Après quoi, nous continuâmes à travailler jusqu'à ce que la lumière de la claire-voie disparaisse et qu'il faille allumer les lampes.
Le journal Últimas noticias possédait son propre immeuble sur le Paseo Colón : une masse sombre de six étages. J'arrivais tôt, avant le ménage, alors que la salle de rédaction était encore couverte de la cendre d'une infinité de cigarettes et de papiers froissés qui cachaient des débuts d'articles ratés. Les vitres étaient toujours sales, encrassées par des années de fumée, et la lumière extérieure ne se décidait jamais à entrer. Avant de me mettre au travail, je parcourais lentement, d'un bout à l'autre, la salle de rédaction en repérant les machines que j'allais devoir réparer ce jour-là. Si l'une d'elles était en panne, je la posais verticalement. Certaines portaient des inscriptions sur le socle : quand un journaliste mourait – ce qui à cette époque n'avait rien d'insolite étant donné leur vie nocturne déréglée –, on notait son nom et ses deux dates au Tipp-Ex blanc dont on se servait pour les corrections. Ainsi, celui qui utilisait la machine savait qu'elle avait appartenu à tel ou tel éminent journaliste.
C'étaient des machines dures, la plupart avaient été achetées au lancement du journal. Walton, le fondateur, s'était rendu en 1932 à Bayonne, dans le New Jersey, pour visiter la fabrique et commander des machines – Underwood modèle 5 – car il aimait tout faire en personne. Une photo de Walton sur le port, près des caisses, trônait, encadrée, au rez-de-chaussée du journal. Quiconque effectuait une visite à la rédaction voyait en premier lieu l'arrivée des machines au port et Walton coiffé d'un chapeau à large bord, que le vent s'obstinait à vouloir emporter. Il mourut quinze ans après la fondation du journal, et son fils, qui prolongeait ses études de droit au-delà de toute limite raisonnable, se retrouva directeur.
Les mains douces et véloces d'une dactylo n'auraient jamais abîmé une de ces Underwood, fût-ce en un siècle, mais la frappe des journalistes était lourde et les machines devaient supporter remords et sautes d'humeur, qui se manifestaient par de brusques coups au chariot ou des coups de poing sur le clavier. Tout au long de la journée, de multiples émotions affectaient la rédaction et toutes laissaient des traces sur les machines.
J'étais chargé de nettoyer le mélange de crasse et d'encre qui effaçait le contour des lettres ; je graissais les mécanismes, vérifiais écrous et vis, et remplaçais les ressorts minuscules. Absorbé par mon travail, je percevais à peine les mouvements autour de moi : d'abord les employés de ménage qui aéraient les lieux et balayaient les restes de la nuit – y compris quelque journaliste, en général Germán Hulm, qui s'était endormi dans les fauteuils de cuir vert du hall –, puis arrivait Mme Elsa, chargée de l'horoscope, la première de la rédaction à venir, et dix minutes après, Felipe Sachar, qui entrait avec une serviette râpée, bourrée de papiers, toujours sur le point d'exploser, mais qui s'ouvrait à l'instant où il atteignait sa table, comme si ce chaos portatif cachait un mécanisme d'horlogerie. J'aidais Sachar à ramasser ses papiers, car il me semblait contre nature qu'un homme aussi volumineux se mette en contact avec les régions inférieures.
Felipe Sachar se définissait comme croisadiste (“Dire que je suis un croisé serait exagéré”) et avait fait imprimer des cartes avec son nom et sa profession. Il insistait : “Le métier de ceux qui, comme moi, travaillent avec un dictionnaire ne figure dans aucun.” Grand et robuste, il portait toujours la même veste à carreaux. Son jeu était baptisé “cryptogramme” car, une fois les cases remplies, apparaissait une phrase cachée (phrase que Sachar tirait d'une anthologie de citations célèbres, laquelle abusait d'Oscar Wilde et de Montaigne). Les mots croisés étaient publiés en dernière page, avec l'horoscope et trois séries de vignettes de bandes dessinées achetées aux syndicats nord-américains. Sachar partageait la page avec l'Agent X9, Trifón et Sisebuta, et une bande dessinée de guerre dont je ne me rappelle pas le nom, dans laquelle un officier demandait des renforts par radio. À côté des mots croisés, il y avait une rubrique intitulée “Le monde de l'occulte”, où il était question de médiums, de spirites, d'hypnotiseurs et d'acolytes de Madame Blavatsky. Elle était signée Mister Peutêtre.
Imaginant qu'entre l'auteur du “Monde de l'occulte” et l'astrologue devait exister une certaine complicité, je demandai à l'aimable Mme Elsa si elle savait qui se cachait sous ce pseudonyme.
-Seul le directeur le sait, répondit Mme Elsa en sortant un tricot de son sac, comme elle le faisait toujours dès qu'elle avait terminé de rédiger son texte.
Même en été elle tricotait des écharpes. Elsa était une des rares personnes de la rédaction capable de taper avec ses dix doigts, si bien que je n'eus jamais à réparer sa machine, dont elle prenait soin comme d'un enfant.
-Tous les après-midi, une enveloppe au nom de M. Walton arrive au journal. C'est tout ce que je peux vous dire.
-Ce doit être quelqu'un qui connaît très bien les milieux ésotériques, dis-je, histoire de parler.
Sachar intervint :
-Il n'y a pas grand-chose à connaître. Ceux qui donnent dans l'ésotérisme répètent toujours les mêmes choses. De phénomènes différents, ils tirent les mêmes conclusions. Ils trouvent des messages partout : dans les pyramides, les cartes, les étoiles, le marc de café. Je ne me rappelle plus qui a dit que l'occultisme est la métaphysique des idiots.
Vexée, Mme Elsa détourna la tête et se concentra sur son tricot. Sachar voulut alors se rattraper :
-Je vous assure que je ne pensais pas à l'horoscope. La divination est une chose, l'astrologie en est une autre, c'est presque une science. Je suis Taureau et vos prédictions tombent toujours justes.
-C'est vrai ?
-Parole ! répondit Sachar en posant la main droite sur son cœur. De plus, je n'oublie pas l'écharpe que vous m'avez tricotée l'hiver dernier.
-Vous l'avez encore ?
-Je l'ai oubliée dans un taxi. Mais j'en garde la sensation autour de mon cou. Au fait, madame Elsa, cette couleur me va très bien.
Quant aux prédictions de l'astrologue, Sachar disait la vérité : l'horoscope était assez vague pour que chacun y trouve son compte. Avec les années, les prédictions avaient été remplacées par de sages conseils : comme une bonne fée, Mme Elsa faisait de la propagande en faveur de l'honnêteté, de la fidélité et de la ténacité.
Les articles de Mister Peutêtre ne faisaient pas autant l'apologie des professionnels de la divination que le prétendait Sachar. Le “croisadiste” était jaloux – du moins je le pensais – car ces dernières années les articles en question s'étaient amplifiés au détriment des fêtes à souhaiter, tandis que les mots croisés n'avaient pas plus de place qu'au début du journal. Mister Peutêtre choisissait chaque jour un personnage différent et exposait sa méthode de travail sans jamais affirmer que son pouvoir était réel. Il racontait l'histoire de l'art divinatoire sans juger de son efficacité. Très souvent, sa rubrique se composait de petits textes, parfois très brefs et incompréhensibles, comme des informations en code pour lecteurs avisés. -Ces articles poussent les gens à croire à des choses qui n'existent pas, disait Sachar en traçant au crayon à pointe grasse ses diagrammes impeccables. Moi, j'essaie d'éduquer le lecteur à travers mes définitions. Je le promène à travers l'histoire, la littérature, la peinture, la botanique…
Surtout la botanique. Sachar usait et abusait d'un dictionnaire de plantes, auquel il avait recours chaque fois qu'il devait réunir en un mot des lettres que la langue espagnole avait du mal à supporter ensemble. Ainsi surgissaient ces définitions qui étaient le cauchemar des lecteurs : famille de dicotylédones à feuilles simples, alternées, fleurs en chatons, fruit indéhiscent avec pépins sans albumen. Ils germaient rarement.
Quand j'avais terminé de réviser la dernière machine, je rangeais les outils dans ma valise et je m'asseyais pour parler avec Sachar, malgré la fumée de sa pipe qui était pour lui une manière de se tenir à un mètre et demi de distance du reste du monde. De temps en temps, il m'expliquait les trucs de son travail. Si je ne m'étais pas assis pour parler avec lui, si je n'avais pas écouté ses explications, ma vie aurait pris un cours totalement différent. Il n'est pas d'exercice aussi vain que celui de se mettre à réfléchir au passé et à se dire : si au lieu d'aller à ce rendez-vous je m'étais abstenu, si au lieu de passer ce coup de téléphone… Mais comment se soustraire à ce jeu ? Nous croyons que toutes nos décisions sont hasardeuses, qu'elles ne sont pas liées, jusqu'à ce qu'apparaisse, nette et tardive, la phrase cachée.
Un matin, je trouvai Sachar la tête appuyée contre sa machine à écrire. Ce n'était pas une posture rare chez d'autres journalistes, qui dormaient souvent pendant leur travail (à cette époque, la nuit avait un prestige qu'elle a perdu ensuite et dormir dans la journée était la preuve que l'on menait une vie intense). Mais cette conduite était impensable chez Sachar. La veille, il m'avait dit qu'il resterait travailler tard. Il voulait prendre de l'avance dans ses mots croisés pour aller jouer au casino de Mar del Plata. C'était une habitude qu'il respectait tous les mois. Je vais à la plage, disait-il en plein hiver, et je l'imaginais seul, un verre de whisky à la main, perdant son salaire à la roulette en essayant de découvrir une logique particulière sous les combinaisons du hasard. Il devait rentrer chez lui à pied depuis la gare de Constitución, car il perdait tout, il ne lui restait pas même pas assez d'argent pour prendre un taxi.
Plié en deux sur la machine, il ressemblait moins à un homme qu'à une construction effondrée à la suite d'un cataclysme. Peut-être était-il mort pendant que ses collègues occupaient encore la salle de rédaction : son bureau était à l'écart, un peu caché derrière une colonne. Je regardai un moment ce monument funèbre sans savoir quoi faire, jusqu'à ce qu'un employé vienne m'aider à redresser le corps. On entendait dans un coin les sanglots étouffés de Mme Elsa ; sur sa table gisaient abandonnées la laine et les aiguilles. Les touches du clavier s'étaient incrustées si profondément dans le front de Sachar qu'elles lui avaient laissé des marques violacées. En quelques secondes, je pris conscience, peiné, que je ne savais rien de Sachar. Dans nos nombreuses conversations, je ne lui avais jamais demandé s'il était marié, s'il avait des enfants, ou ce qu'il faisait avant de devenir “croisadiste”.
Après qu'on eut emporté le corps, Lajer – de la rubrique hippique –, qui était un de ses vieux amis, fouilla les tiroirs. Il y trouva une paire de ciseaux, des papiers, des dictionnaires et un canif. Il releva la machine pour écrire le nom, mais nous découvrîmes alors que Sachar lui-même avait pris les devants, alerté par quelque prémonition.
F. Sachar
1878-1950
© Editions Métailié
La confrérie des buveurs de sang
publié le 08 mars 2012 à 09:57
Et pourtant, nous passerions une bien meilleure nuit si nous renoncions à chasser en agitant un balai et en poussant des cris horrifiés la chauve-souris entrée malencontreusement dans notre chambre par un doux crépuscule d'été et par la croisée entrouverte. Fermons plutôt cette fenêtre, tirons les rideaux, la chauve-souris veillera sur notre sommeil, elle exterminera les vrais suceurs de sang que sont les moustiques, elle éventera nos fronts moites de son aile silencieuse. Car nous avons alors affaire le plus souvent à l'inoffensive et insectivore pipistrelle et jamais, pratiquement jamais, au Desmodus rotundusqui, quelquefois, en effet, saigne un boeuf entier dans la pampa. Il est plus rare encore que ce petit monstre craintif se révèle être quelque Nosferatu métamorphosé, venu boire à la source le seul vin qui l'enivre - et quand bien même, s'il faut mourir, cette fin-là ne serait pas la pire, qui blesse à peine notre gorge de deux trous imperceptibles et fait de notre corps un gisant marmoréen enfin maître de ses émois et de ses palpitations ; sachons l'accueillir dignement.
Depuis Le Vampire (1819), de John William Polidori, puis, surtout, le Dracula (1897), de Bram Stoker, la littérature - toujours suivie comme son ombre par le cinéma - a fait de cette figure un mythe gothique et même un genre en soi : donjon surgissant du brouillard, cercueils, canines acérées, gousses d'ail et crucifix, le romancier délègue au décorateur et à l'accessoiriste la plus grosse partie de son travail. Le premier mérite de l'écrivain argentin Pablo de Santis est donc de renouveler le genre en y injectant un peu de sang neuf.
Il commence par décrocher des cintres les brumes mitées de Transylvanie pour situer l'intrigue de La Soif primordiale dans la Buenos Aires des années 1950, et son livre s'ouvre comme un classique roman d'initiation : le jeune narrateur quitte son village et découvre la ville. Santiago Lebrón travaille d'abord comme apprenti chez son oncle, réparateur de machines à écrire électriques - "Olivetti, Corona, Underwood, Hermès, Continental, Remington, Royal" : on peut se fier à ces belles mécaniques pour noircir du papier sans perdre le sens des réalités.
Lire la suite sur LeMonde.fr
currentVote
noRating
noWeight
La soif primordiale: Vampire, y'a pas pire
Pablo de Santis est-il un vampire ?Dans un roman que ne renierait pas le barcelonais Carlos Ruiz Zafon, le romancier argentin Pablo de Santis mêle goût des livres et surnaturel vampirique. Les amateurs de Twilight peuvent aller se faire cuire un steak (bleu de préférence) : la Soif Primordiale fait exactement ce qu'il faut faire pour prendre le mythe à sa source XIXème et lui donner des airs de jeunesse intelligents. Amateurs de frissons lettrés bienvenus, ceci est un (petit) chef d'oeuvre du genre. Découvrir un livre de vampires en 2012, c'est comme découvrir du pétrole au Moyen-Orient dans les années 1960 : un truc qu'on fait tous les jours et qui met un peu mal à l'aise. Il y a eu tellement de saloperies écrites sur les buveurs de sang et autres monstres des Carpates depuis que la vague vampirique bat son plein qu'on désespérait de trouver un jour quelque chose d'appétissant à se mettre sous les canines. Heureusement pour nous, Pablo de Santis, quadragénaire finissant et touche à tout de Buenos Aires, arrive et c'est une excellente nouvelle. L'homme s'est fait connaître par quelques romans dont le déjà remarqué Cercle des douze. La soif primordiale semble (on n'a pas tout lu de ses 4 romans) sortir du lot par son ambition et sa virtuosité. Dans les années 50, alors que l'Argentine respire mal sous la coupe de la dictature, un jeune homme sans véritable emploi (il répare des machines à écrire) va se retrouver embauché dans un journal en vue. Suite à la disparition d'un journaliste, Santiago reprend à son compte la rubrique « ésotérique » du journal. A cette occasion, il est mis en contact, lors d'une convention mystérieuse, avec « les antiquaires », des types bizarroïdes qui vivent entourés de vieux objets, s'échangent des livres rares et sont habités par la « soif primordiale ». Les antiquaires sont évidemment des vampires que chassent et traquent une bande d'aristocrates et de modernistes. De Santis reprendra par la suite les codes du genre : il y a les bons et les méchants, le passé sombre, les fous furieux et les sages, le sang de synthèse qui permet d'éviter de dévorer de l'homme frais, etc. La soif primordiale est un immense roman fantastique et social dans ses 100 premières pages. Le personnage de Santiago est dessiné en quelques coups de pinceaux remarquables : provincial un peu timide, puis reporter naïf. Il n'y a guère mieux que le début du roman qui nous plonge dans la normalité d'une ascension sociale pleine d'espérance et d'énergie. Les descriptions du journal sont parfaites. La disparition de l'aîné qui fait à la fois la rubrique ésotérique et les mots croisés superbe. Le jeune journaliste informe aussi le ministère où un employé fantomatique vit l'aventure par procuration. C'est un sans faute. Suce ou crève Santiago s'approche un peu trop près du mal. Il tombe amoureux fou et finit, comme on s'en doute, transfusé par du sang contaminé. Devenu vampire lui-même, il prend son médoc et intègre les rangs des bouquinistes. De Santis réussit à la quasi perfection à faire comme Zafon : il fait respirer les vieilles villes, les livres, le mystère des romans... mystérieux. C'en est presque caricatural mais on marche à fond entre les après-midi poésie et les virées chez les bouquinistes codés. L'amoureuse est la fille du chasseur de vampire. L'immortalité porte la tragédie : finie vie sociale, amis, famille. C'est réclusion et lamentation/damnation éternelles, le visage pâle et le nez qui coule. La seconde partie du roman est moins surprenante que la première. L'auteur déroule un schéma qu'on a déjà lu chez Stoker lui-même : le problème du passage d'un camp à un autre, la peur de l'isolement et l'enracinement de la différence. Cela n'en reste pas moins extrêmement bien fait. Le lecteur est saisi à la gorge par la façon dont son gentil reporter se laisse contaminer par le mal (il y a cette scène vaguement érotique où il suce sa mie dans le noir...) et perd ses repères. Dans une tentative assez branque d'améliorer les choses, le gentil Santiago précipite l'arrivée du bordel qu'on attendait. C'est l'affrontement, l'effondrement et le temps de la philosophie qui reprend tout à zéro. La fin du roman, après un petit passage en roue libre, se remet à la hauteur du début : on boit à cette Soif Primordiale comme si c'était du nectar et pas autre chose. Entre les vieux livres qui passent de mains en mains, la fille qui désire et l'ambiance Buenos Aires milieu du siècle, poussiéreux et droit du bulbe, c'est le bonheur complet. On frémit, on frissonne, on gémit et on joue au vampire avec la première jolie fille qui passe. Voilà un livre qui rend fort et sournois à la fois. Dire que la soif primordiale donne un coup de frais au mythe du vampire serait faire injure au genre. Le roman sent la viande faisandée, la naphtaline et la romance poussiéreuse. La soif Primordiale est un roman qui délaisse les effets de manche de l'époque pour s'intéresser autant à ses monstres qu'au temps qui passe et à l'environnement. Comme chez Stoker, ce n'est pas le vampire lui-même qui compte mais la perspective déployées par le passage d'un état à un autre, le rapport au groupe et à la passion. De Santis réussit un livre à la fois exaltrant, cultivé et envoûtant. C'est beaucoup et c'est bien peu. Il ne faut pas se laisser beurrer les lunettes par le savoir-faire. C'est du bon boulot et puis c'est tout.
Par Daniel De Almeida
source: http://fluctuat.premiere.fr/Livres/News/La-soif-primordiale-Vampire-y-a-pas-pire
currentVote
noRating
noWeight
La Soif primordiale (Los anticuarios), traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry, février 2012, 256 p., 18,5 €
Ecrivain(s): Pablo de Santis Edition: Métailié
Buenos Aires, 1950. Le lieu et la date suffisent à planter le décor : nous sommes dans l’Argentine de Perón, les hommes portent chapeaux, on fume, on boit du gin et du maté, on va jouer sa paye au casino de Mar del Plata. C’est l’hiver en juin et l’été en décembre. Il pleut sur les demeures patriciennes. Buenos Aires est une ville littéraire, littéraire en diable. Buenos Aires est aussi, et plus encore que n’importe quelle autre ville latino-américaine, un petit bout d’Europe, un territoire culturellement européen. Buenos Aires est aussi – surtout ? – LA ville où le fantastique dessine un paysage – un labyrinthe ? – mental.
Mais n’allons pas trop vite, et concentrons-nous, tout d’abord, sur la trame de l’excellent roman de Pablo de Santis, La Soif primordiale, que les éditions Métailié publient en ce mois de février 2012. Le héros, Santiago Lebrón, arrive de son village, est petit apprenti puis rédacteur dans un journal. Puis libraire d’ancien. Il arrive à Buenos Aires à l’âge de vingt ans, se loge dans une pension modeste, et aide son oncle dans son atelier, où l’on répare des machines à écrire.
Trois ans plus tard, on le retrouve au journal Últimas noticias. On lui confie la rubrique des mots-croisés, et celle, plus surprenante, qui traite de l’ésotérisme. C’est que le rédacteur qu’il remplace, Sachar, était aussi Mister Peutêtre, le chroniqueur de l’occulte. Santiago Lebrón va ainsi entrer en contact avec le commissaire Farías, qui, depuis qu’on lui a fixé une plaque de métal sur la tête suite à une blessure, entend des voix, et dont la voiture lui sert de bureau. Ce commissaire, qui n’appartient pas « à la police normale », dit travailler pour le ministère de l’Occulte qui « surveille l’activité des spirites, des devins, des sectes ». Ce ministère de l’Occulte, bien entendu invisible – « occulté » – occupe le bureau 665 de la poste centrale dans lequel règne « un homme chauve, malingre, avec des lunettes rondes » : monsieur Crispino.
À partir de ce début prometteur, le texte déploie une trajectoire impeccablement romanesque, haletante. Santiago Lebrón intègre le cercle du professeur Balacco qui se réunit dans un hôtel étrange, tombe amoureux de sa fille qui est fiancée à un champion d’escrime, part en quête des « antiquaires » (les anticuarios du titre original), fait la connaissance du libraire Calisser, propriétaire de la libraire d’occasion La Forteresse et… à la page 107… Mais chut !…
Les « antiquaires », sujets de l’enquête menée par Lebrón sur ordre de Farías, sont « une espèce particulière de malades, qui avaient fait de leur mal un culte. […] Trois traits caractérisent ce mal : une longévité anormale, la capacité d’évoquer chez les autres le visage ou les gestes de personnes décédées et la soif du sang, que les antiquaires appellent soif primordiale », explique Crispino. Lors de sa première rencontre avec le professeur Balacco, Santiago apprend également que les antiquaires « se cachent de la lumière. Ils forment autour d’eux un cercle avec de vieux objets. Ils sont collectionneurs par nature. Ils fuient la nouveauté ».
Pablo de Santis renouvelle le mythe du vampire en milieu urbain, et plus encore. Il en fait un motif moins romantique, moins fantastique, que social. Nous sommes très très loin de Twilight !
La Buenos Aires de la seconde partie du roman devient nocturne, souterraine, plus mystérieuse qu’effrayante, tout en restant quotidienne. Car la ville est un personnage du roman, on la parcourt précisément, on retrouve les noms des rues, des avenues, des quartiers – la Recoleta, Corrientes, San Telmo, Boedo… La Buenos Aires de La Soif primordiale n’est pas sans rappeler celle du « Rapport sur les aveugles », ce chapitre halluciné de Héros et Tombes d’Ernesto Sábato, une Buenos Aires symbolique, fantasmatique, que l’on parcourt comme on descendrait en soi-même, que l’on explore à la recherche de sa propre vérité : « Mes coups à la porte ne résonnaient pas, comme si la maison dévorait les bruits, mais brusquement la porte s’ouvrit sur une femme albinos et aveugle, aux bras longs et maigres. J’eus la sensation qu’elle me flairait… »
Dans l’inconscient littéraire – disons-le ainsi – Buenos Aires est aussi la ville de Borges et de sa bibliothèque. La librairie d’ancien, La Forteresse, l’évoque aussi, par sa pénombre et ses dédales : « Cela fait maintenant de nombreuses années que je suis propriétaire d’une librairie de livres d’occasion. Elle se trouve dans le passage La Piedad ; la rue est étroite, ce qui évite d’être accablé par le soleil. Je me sens protégé par les livres qui forment des parois irrégulières, les murailles de mon château ».
En ce qui concerne l’intrigue et l’atmosphère, plus que vers la gothiquissime et mélodramatique Ombre du vent de Zafón, c’est vers Pérez Reverte et son délectable Club Dumas que l’on penche. Dans La Soif primordiale, il est aussi question de mettre la main sur un livre singulier, magique, l’Ars Amandi, un « livre que l’on ne peut pas ouvrir à n’importe quelle page. Seulement dans un certain ordre. Si on se trompe de page, le livre s’enflamme ».
Ces strates d’inspiration et de références – il en est bien d’autres encore, de Jules Verne et Edgar Poe à Villiers de l’Isle-Adam, Virgile… – font de La Soif primordiale un roman absolument réjouissant.
Mais la Buenos Aires du roman est aussi et surtout celle de la traque et des pratiques policières plus que musclées. La torture y est évoquée :
« Avant, quand je devais parler avec quelqu’un, je l’emmenais au cirque.
– Pour voir le spectacle ?
Le commissaire se mit à rire.
– Non, en dehors. Les cirques ont de nombreux éléments qui permettent de travailler. Il suffit de laisser quelqu’un suspendu au trapèze. Ou de l’attacher à la cible tournante du lanceur de couteaux. Ou de l’enfermer dans la caisse du prestidigitateur et de le transpercer de coups d’épée ».
La torture y est aussi représentée sous la forme d’une « Machine du destin », un tour de dentiste sur lequel on a fixé un bistouri, et qui sert à remodeler les lignes de la main pour changer son destin. Dans les mains du commissaire Farías, cette machine à escroquer devient machine à torturer. L’atmosphère politique de l’Argentine des années 50 est bien présente, primordiale : « Ils nous contrôlent à travers le papier. Le sous-secrétariat des diffamations publiques, comme l’appelait Sachar, nous tient dans sa ligne de mire, mais tant qu’au ministère de l’Occulte ils sont contents, tout va bien. Des bureaucrates nous sauvent d’autres bureaucrates » explique le rédacteur en chef du journal. La chasse aux vampires sous-tend la délation, la traque, l’assassinat. Les événements les plus marquants de la vie de Santiago ont lieu à des moments-clés du péronisme : la mort d’Evita (1952), la chute et la fuite de Perón (1955).
La Soif primordiale est un roman subtil, truffé de références et d’allusions, qui se lit avec délice.
currentVote
noRating
noWeight
| |
Le Cercle des douze
Pablo de Santis
éd. Métailié
traduit de (Argentine) l’espagnol parpar René Solis
19,00 €
Le narrateur, Sigmundo Salvatrio, modeste fils de cordonnier et passionné de crimes, s’inscrit dans un cours pour devenir détective. Son maître, Craig, le « choisit » pour le représenter à l’exposition universelle de 1889. En effet, à cette occasion, le cercle des douze se réunit (les douze meilleurs détectives du monde) et doit présenter une exposition des objets leur ayant permis la résolution d’énigmes. Peu de temps après son arrivée, l’un des détectives est assassiné et Sigmundo se voit confier la tache d’assister le détective Arzaky dans l’enquête.
Nous voici dans un polar écrit dans la plus pure tradition, les codes classiques sont tous réunis. Nous voici aussi dans un roman dont l’intérêt n’est pas de savoir qui a tué mais le déroulement, le pourquoi. Il dissèque les relations, les mœurs des détectives, leurs différentes manières de faire fonctionner les fameuses « petites cellules grises » chères à Hercule Poirot.
Cet auteur argentin nous plonge dans le Paris de la fin XIXe et nous décrit la société de l’époque, les conservateurs face aux progressistes, les sociétés secrètes, les filles de joies. Un pur moment de plaisir en hommage aux premiers écrivains de romans policiers.
Delphine Gorréguès
La Réserve - Mantes la ville, le 10 novembre 2009
|
source: www.initiales.org/Le-Cercle-des-douze.html
|
|
Le cercle de Douze
de Pablo de Santis

Éditeur : Anne-Marie Métailié
Collection : BIBLIOTHEQUE HISPANIQUE
Genre : ROMAN CONTEMPORAIN
Présentation : Broché
A la veille de l'inauguration de l'Exposition universelle de 1889, les plus célèbres détectives du monde et leurs assistants ont rendez-vous à Paris pour une réunion du Cercle des douze, l'organisation qu'ils ont créée. Dès les premiers jours, l'un d'eux est assassiné sur la tour Eiffel encore en chantier. Aux côtés de Viktor Arzaky, détective polonais vivant à Paris, le jeune Sigmundo Salvatrio, fils d'un cordonnier de Buenos Aires, mène une enquête qui l'entraîne dans les zones d'ombre de la ville lumière, où se terrent sectes ésotériques et autres ennemis du progrès. Dans le Paris de la fin du XIXe siècle, Pablo de Santis trouve un cadre idéal pour explorer des thèmes qui lui sont chers, à la lisière du rationnel et du fantastique. Le jeune Sigmundo va découvrir que la ville entière est une écriture secrète à déchiffrer, et que la vérité se cache peut-être sur les lèvres de la Sirène, danseuse dans une mer de glace...
|
Eduardo Mendoza a dit de ce roman : « C’est un incroyable roman d’intrigues mais c’est également tous les romans d’intrigue à la fois ». A dire vrai, comme toujours, Eduardo Mendoza a le sens de la formule et de la critique. Toute la beauté du roman réside dans cet incroyable sens de l’écriture de De Santis qui lui permet à la fois de nous plonger dans plusieurs intrigues différentes en nous posant la véritable question de l’intrigue en général. → plus
|
Le Théâtre de la mémoire
de Pablo de Santis, René Solis (Traduction)
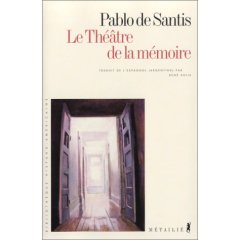
Broché: 153 pages
Editeur : Métailié (5 septembre 2002)
Collection : Bibliothèque Hispano-Américaine
Etrange destinée que celle du docteur Nigro, spécialiste de la mémoire et dont on a du mal à se souvenir, au point qu'il est surnommé le "docteur Personne". En enquêtant sur la vie d'un amnésique arrivé dans son service, Nigro va découvrir l'amour avec Luciana, la femme de son patient, puis plonger au cœur du mystère de l'institut Fabrizio, où il a été formé avant d'en être écarté.Au centre de l'enquête se trouve le théâtre de la mémoire de Giulio Camillo. Un édifice fantastique qui se veut représentation du monde et support de la mémoire, conçu à partir de fragments de cartes, de plans inachevés et de la tradition orale. L'architecte qui tentait de le reconstituer a brusquement disparu. Son fils a perdu la mémoire pour avoir lu ses notes.Que faisait en réalité Fabrizio, son maître, entouré de son étrange "triumvirat", Lex, Mosca et Lisi. A quelles manipulations se livrait-il sur le cerveau et la mémoire ? Quel destin avait-il réservé à Nigro, son plus jeune élève ?Comme dans La Traduction, De Santis marche sur les traces de Borges. Avec son héros, il s'interroge sur la mémoire, sa conservation et sa transmission, dans un texte où tout est signe à déchiffrer, mais son enquêteur est un homme amoureux qui souffre.
|
Le Théatre de la Mémoire
→ plus
|
Le docteur Nigro est atteint d'un léger syndrome d' "invisibilité" : visage quelconque, personnalité insignifiante, il ne semble posséder aucune aura... des caractéristiques qui lui valent le surnom de "Docteur Personne" dans l'hôpital où il travaille. Comble du paradoxe pour un médecin qui est spécialiste de la mémoire... Ce n'était nullement le cas de son maître, le docteur Fabrizio, éminent chercheur passablement farfelu et mégalomane, qui avait fait édifier un institut, bâtiment complexe ("projection" de sa personnalité), comprenant un "théâtre de la mémoire", un amphithéâtre inversé érigé en l'honneur de l'harmonie universelle...
Quand arrive dans son service de neurologie Diago, un homme "entre parenthèses", c'est-à-dire amnésique, Nigro est de nouveau forcé de se replonger dans le monde étrange et vertigineux de son ancien professeur, mort depuis quelques années : le père du malade était un ami de Fabrizio, un architecte reconnu, qui lui aussi avait participé à la conception du bâtiment de la fondation Fabrizio. La curiosité de Nigro est attisée et avec l'aide de Luciana, l'ex-femme de l'amnésique, il tente de comprendre pourquoi Diago, avant de plonger dans les gouffres de l'oubli, avait passé des mois à explorer les archives de feu son père, à la recherche d'une improbable clé qui expliquerait sa disparition soudaine. Nigro hérite en quelque sorte de l'enquête inachevée de son patient (et par la même occasion de son ex-femme), dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur Fabrizio, dont la mort n'a pas éradiqué l'incroyable ascendant qu'il avait sur le jeune docteur : "Fabrizio était mon thème", avoue-t-il.
Ce roman peut donner froid dans le dos : personnages proches de la démence, individus désemparés ou en marge, s'agitant comme des marionnettes ; psychologie, architecture et métaphysique se côtoient sans scrupules dans ce roman où les morts sont plus vivaces que les vivants eux-mêmes, réduits à l'état de fantômes.C'est tout particulièrement l'évocation des recherches de Fabrizio (typique "professeur fou"), qui manipule le cerveau comme d'autres les gènes, qui procure de véritables frissons : construction de faux souvenirs, mémoires capables d'être remplies de données artificielles, et son terrible legs à des associés aussi déments que lui, assoiffés de pouvoir.
Quête identitaire et faux polar scientifique, Le Théâtre de la mémoire est une exploration érudite et intense de la nébuleuse qui compose l'esprit humain, un labyrinthe chaotique et tortueux, que même les spécialistes ne semblent pas compétents à maîtriser...
B.Longre(août 2002)
www.sitartmag.com
|
Plus d'articles (21 articles sur 2 pages):
|
Calendrier
Juillet 2015
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|


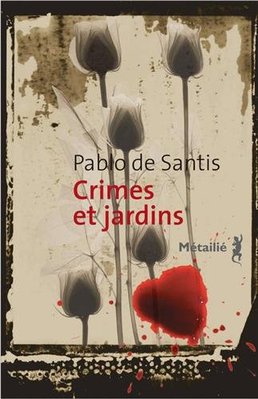



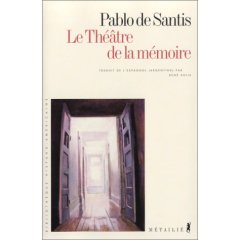
Derniers commentaires
→ plus de commentaires