|

Regard clair, mèche blonde, élégance discrète, Hector Bianciotti avait gardé une allure juvénile. (Ulf Andersen - Sipa)
Créé le 13-06-2012 à 08h04 - Mis à jour à 08h05
Hector Bianciotti est mort
Par Le Nouvel Observateur avec AFP
Elu à l'Académie française en 1996, l'écrivain d'origine argentine a signé dans les colonnes du "Nouvel Observateur" de 1973 à 1986.
Hector Bianciotti, qui vient de mourir à l'âge de 82 ans à Paris, était un écrivain rare d'origine argentine, qui maniait à la perfection la langue française après l'avoir adoptée pour son œuvre.
Son quatrième roman, "Le pas si lent de l'amour", une "autofiction", selon son expression, raconte son exil, depuis l'Argentine, où il était né en mars 1930, vers l'Italie et l'Espagne et la lente "métamorphose" qui lui fait adopter le français.
Le choix de la langue française correspond à "un formidable besoin de s'exprimer" et de "retrouver dans cette conversion l'éblouissement éprouvé à 15 ans pour le mysticisme de la poésie au travers de quelques vers de Paul Valéry extraits de 'La Jeune Parque'".
Tout jeune, il dévore Baudelaire, Mallarmé, Verlaine. Adolescent, racontait-il, "il y a eu Sartre et le choc fulgurant de 'L'Etranger' de Camus".
"Changer de langue", disait-il, "c'est modifier sa façon d'être, sentir différemment". Ne détestant pas le paradoxe, il affirmait qu'on peut être désespéré dans une langue et à peine triste dans une autre.
L'écrivain avait été naturalisé français en 1981, puis élu à l'Académie française en 1996 où il avait rejoint les quelques immortels non français ou d'origine étrangère qui y siégeaient.
Regard clair, mèche blonde, élégance discrète, Hector Bianciotti avait gardé une allure juvénile.
Son premier roman écrit en français, "Sans la miséricorde du Christ", obtient le prix Femina 1985. Suivent "Seules les larmes seront comptées" (1988) et "Ce que la nuit raconte au jour" (1992). Auparavant, il avait écrit en espagnol "Le Traité des saisons" (Prix Médicis étranger 1977), et un recueil de nouvelles "L'Amour n'est pas aimé", couronné en 1983 du prix du Meilleur livre étranger.
Son œuvre, récompensée par le Prix littéraire Prince Pierre de Monaco, se définit pour le poète cubain Severo Sarduy par "ce tempo singulier et dilaté, si propice à la subite incandescence du baroque".
Découvert par Maurice Nadeau
Né dans la pampa de Cordoba, paysage "sans limite" et "sans issue", Hector Bianciotti quitte l'Argentine en 1955. Arrivé à Paris en 1961, découvert par l'éditeur Maurice Nadeau, il signe en 1969 dans "La Quinzaine littéraire". De 1973 à 1986, il devient journaliste littéraire au "Nouvel Observateur", avant d'écrire pour "Le Monde".
Personnalité importante de la République des Lettres, il passe en 1989 de Gallimard à Grasset, où il siège au comité de lecture et dont il est l'un des conseillers du président. Il préside également la commission Littérature étrangère du Centre national du Livre.
Hector Bianciotti est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont le roman, "Nostalgie de la maison de Dieu" (Gallimard), a été publié en 2003, avant "Lettres à un ami prêtre", sa correspondance avec Benoît Lobet paru en 2006.
source: http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20120613.OBS8511/hector-bianciotti-est-mort.html
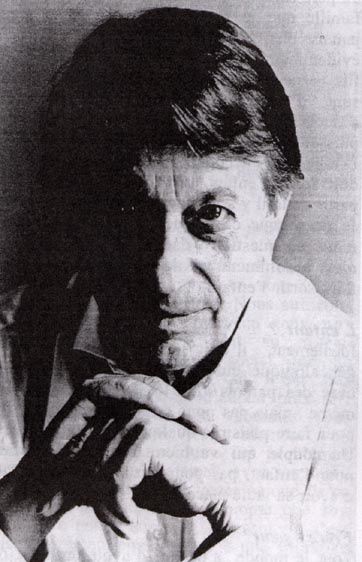
Hector Bianciotti est né le 18 mars 1930, de parents piémontais, dans cette région de l’Argentine que les écrivains appellent la Pampa. Il a été élevé dans la crainte de ne pas parler assez bien la langue du pays. Ses parents avaient souffert de ne pas posséder l’espagnol et si, entre eux, ils utilisaient le dialecte piémontais, ils en interdisaient l’usage à leurs enfants. Ainsi peut-on dire qu’il n’a pas eu de langue maternelle, car elle lui fut interdite, et l’espagnol, imposé. Il avait douze ans quand il est entré au séminaire ; dix-huit lorsqu’il en est sorti. Il y avait commencé, en 1945, à étudier la langue française en confrontant quelques textes en prose de Paul Valéry à leur traduction espagnole. Il quitta l’Argentine en février 1955. S’arrêta à Rome. Y connut la faim. Il vécut quatre ans en Espagne, avant d’arriver à Paris, en février 1961. Un an plus tard, il commençait à rédiger des rapports de lecture pour les éditions Gallimard. En 1969, à la demande de Maurice Nadeau, son premier éditeur, il publiait un article dans La Quinzaine littéraire ; d’autres allaient suivre et, trois ans plus tard, il devenait journaliste littéraire au Nouvel Observateur. Au bout d’une quinzaine d’années et de nombreux articles, il se mit à rêver en français. Entre-temps, il avait écrit quatre romans, une pièce de théâtre et un recueil de nouvelles, traduits en français par Françoise Rosset. À partir de 1982, très conscient des différences d’esprit entre les langues, il n’écrit plus qu’en français. Il est par là fidèle aux admirations de son adolescence, parmi lesquelles Valéry, Claudel et Jouhandeau. Le passage à la langue française marque le dernier temps de ce qui a été vécu comme un retour en Europe. Après être entré d’abord aux éditions Gallimard, qu’il quitte en 1989, il devient membre du comité de lecture des éditions Grasset et Fasquelle. Il est en outre critique littéraire au journal Le Monde. Hector Bianciotti a été naturalisé français en 1981. Il a reçu le prix Médicis étranger, en 1977, pour Le Traité des saisons, ainsi que le prix du Meilleur livre étranger, en 1983, pour L’Amour n’est pas aimé ; en 1985, le prix Femina, pour son premier roman français, Sans la miséricorde du Christ. Le prix Prince Pierre de Monaco lui a été décerné, en 1993, pour l’ensemble de son œuvre, et, en 1994, le Prix de la langue de France. Il a été élu à l’Académie française, le 18 janvier 1996, au fauteuil d’André Frossard (2e fauteuil).
Hector Bianciotti, la liberté et la forme
ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 07.02.92
Jadis on écrivait seulement dans la langue d’un empire ou d’une religion universelle : le latin, le sanskrit, l’arabe. Aujourd’hui, toutes les langues, ou presque, se doublent d’une littérature écrite. La pluralité des littératures entraîne la multiplication des traductions, et ces deux faits accentuent le caractère international de la tradition moderne : nos classiques sont écrits en italien et en français, en russe et en anglais, en allemand et en espagnol, bref, en diverses langues européennes et dans quelques langues asiatiques. Un phénomène moins fréquent, mais tout aussi caractéristique, est l’apparition d’auteurs qui n’écrivent pas dans leur langue maternelle.
Deux grandes littératures, l’anglaise et la française, comptent plusieurs écrivains d’origine étrangère dont l’apport est particulièrement riche : Conrad, Santayana, Nabokov, Ionesco, Cioran, Beckett… C’est à ce groupe qu’appartient l’Argentin Hector Bianciotti : bien que la littérature latino-américaine lui doive des oeuvres très appréciées, aujourd’hui il écrit exclusivement en français. J’ajoute que son français est naturel, élégant, sans archaïsmes ni familiarités, à égale distance de l’expressionnisme et de la préciosité, un français qui n’est pas celui de telle ou telle région, mais celui de la tradition littéraire. Sa prose est régie par le sentiment de la mesure, elle est claire sans succomber aux évidences, alerte, mais sans précipitation. Elle sait nous surprendre par un tour inattendu, une vision grotesque, un bond, une rupture : autant d’intrusions, non pas de la langue espagnole, mais de son génie. Bianciotti pourrait dire de sa prose française ce que Santayana disait de la sienne : ” J’écris les choses les moins anglaises dans le plus anglais des anglais. ”
Sous un titre évocateur, Ce que la nuit raconte au jour, Bianciotti vient de publier des Mémoires de jeunesse qui nous transportent dans la province argentine et à Buenos-Aires. Notre passé est si profondément lié à notre langue que sa résurrection dans un idiome différent est à la fois une découverte et un adieu : la rencontre avec celui que nous étions se transforme en séparation définitive. Le ressuscité se voit dans le miroir d’une autre langue ; en se voyant, il s’identifie, mais en s’écoutant, il ne se reconnaît pas. Le livre de Bianciotti est le récit du lent éloignement de sa terre natale et de celui qu’il fut ; parallèlement, c’est l’annonce d’une lointaine rencontre : en abandonnant le lieu de sa naissance, l’auteur savait obscurément qu’il allait à la rencontre de soi-même.
En effet, le changement de lieu et de langue s’est progressivement transformé en naissance, non d’une autre personne, mais d’un autre écrivain. Ainsi, la résurrection du passé implique sa distanciation : celui que j’étais ne comprend pas mes mots, mais je comprends les siens. La distance n’abolit pas la communication ; au contraire, c’est cela même qui la rend possible : qui je fus parle en moi et je le traduis dans une autre langue. Le pont de l’écriture me permet de communiquer avec mon passé _ et de l’exorciser.
Les ressources de l’ambiguïté
Comme son titre l’indique, le livre de Bianciotti est une histoire que l’auteur se raconte à lui-même. La narration n’est pas linéaire ; tout comme dans les romans, elle avance, recule, recommence, dévie, fait un saut dans l’espace ou dans le temps, poursuit imperturbablement sa marche sinueuse. Bianciotti procède par touches et esquisses, il préfère la suggestion à l’explication, il insinue au lieu de raconter, réduisant chaque situation à quelques éléments essentiels. Il ne décrit pas : il évoque, convoque. Un art plus proche de la musique que de la peinture.
L’auteur utilise toutes les ressources du roman, à commencer par l’ambiguïté. Plus qu’un recours, c’est là un attribut que le roman partage avec la poésie. C’est le trait constitutif de l’imagination littéraire : l’ambiguïté nous laisse percevoir la nature double ou triple de tout ce qui est humain. C’est un procédé littéraire qui présente aussi une valeur morale car il nous enseigne que rien, du sexe à la raison, n’est simple chez l’homme.
L’ambiguïté élude les explications : le dessein de Bianciotti n’est pas d’expliquer, sauf de manière indirecte ; il montre plutôt, il révèle. Pour lui, comprendre le monde, ce n’est pas le déchiffrer mais l’accepter. Et il l’accepte non par le truchement de la raison, mais avec les sens ou, plus exactement, avec cet étrange composé d’intelligence et d’instinct qui définit la sensibilité poétique. Il ne lui a pas été facile d’accepter la réalité ; chaque acceptation a commencé par une négation et chaque rupture a entraîné, à son tour, une réconciliation suivie d’une autre négation encore plus radicale.
La première négation fut celle de l’espace physique : fils d’immigrants italiens voués aux travaux des champs, le protagoniste oppose à l’immense plaine argentine la maison familiale et son jardin sauvage ; plus tard, il quitte la maison pour la ville, puis pour la capitale où, dernière négation, il s’embarque pour l’Europe dans un voyage sans retour. Il fuit l’asphyxiante réalité latino-américaine, sordide mélange d’oppression politique, d’injustice et d’intolérance morale. Les changements de lieux obéissent à des changements psychiques : rigueur et exploration intime, quête de soi-même.
La sexualité s’affirme suivant la même loi de ruptures et d’acceptations : les plaisirs solitaires, où l’adolescent tente une réunion éphémère avec la nature primitive à laquelle il fut arraché en naissant ; la découverte progressive de l’amour en la personne d’un compagnon de séminaire, suivie d’une rupture si profonde que Bianciotti en oublie jusqu’à son nom ; puis l’amour hétérosexuel, sous la forme d’une passion violente avec une jeune comédienne et qui culmine dans une autre rupture.
La négation de la pampa
Le même procédé se répète dans le domaine des idées et des croyances. La famille professe un catholicisme fervent, mais le père est athée, de sorte que la religiosité infantile du protagoniste est aussi une négation du père. Adolescent, Bianciotti renie la religion ritualiste de sa famille, et cette négation se convertit aussitôt en nouvelle affirmation : la décision d’embrasser la vie religieuse. Mais la religion le déçoit : le jeune homme abandonne sa foi pour en découvrir une autre : la littérature. Le grand prêtre du nouveau culte s’appelait Paul Valéry. La foi littéraire est un mélange de doute et de zèle, de peine et de joie quotidiennes, de longs travaux et de brèves illuminations : Bianciotti lui est toujours resté fidèle.
Toutes ces négations et ruptures sont contenues dans la première : la négation de la pampa. Mais comment définir la pampa ? Ce n’est pas la campagne, cultivée et transformée par l’agriculteur sédentaire ; ce n’est pas davantage le cadre de l’Histoire, comme la plaine de l’Asie centrale, sillonnée par des peuples nomades, par des caravanes et des pèlerins bouddhistes. La pampa concentre l’indéfini et l’indéfinissable; en elle, l’origine et la fin, le proche et le lointain, le centre et la périphérie, la culture et la nature, s’annulent et se dissolvent. L’illimité joint à l’indéterminé : voilà un des pôles des Mémoires romanesques de Bianciotti.
A double tranchant
L’autre pôle est l’excès de forme : le pittoresque, le grotesque, l’extravagance. Hypertrophie de la volonté formelle : la Pinotta, la tante visionnaire et vagabonde, avatar féminin de Don Quichotte qui parcourt en haillons les chemins poudreux de la plaine ; Florencio, le suicidaire saltimbanque ; le curé amoureux des Lolita du village ; la bossue lubrique ; la voyante qui bat les cartes lustrées et biseautées pour dire la bonne aventure à ceux qui n’en ont guère… Et les figures à double tranchant, les âmes viles mais soudain illuminées par un éclair de générosité : le couple de policiers, Castor et Pollux au service du génie retors de la délation politique et sexuelle ; l’ami qui trahit et qui, finalement, de façon tout à fait inattendue, offre au narrateur la clé du destin : un aller simple sur un bateau qui cingle vers l’Europe.
Peu à peu, on voit se dessiner le sens de toutes ces ruptures douloureuses, de ces réconciliations et de ces nouvelles fractures : Bianciotti revient sur le Vieux Continent, à la recherche de ses origines, certes, mais aussi d’un autre bien, non moins précieux. Entre le sans-limites et le grotesque, entre l’informe et le difforme, il cherche non pas une norme mais une forme. La liberté est soif d’incarnation, quête de la forme. Voilà ce que la nuit raconte au jour.
PAZ OCTAVIO
© http://abonnes.lemonde.fr/
Hector Bianciotti : “Quand j’écris en français, j’ai peur …”
Hector Bianciotti, romancier d’origine piémontaise, est né en Argentine. Après une enfance paysanne et des études de séminariste, il quitte la pampa pour l’Italie, l’Espagne, puis la France. Un an après son arrivée à Paris, en 1962, il est engagé comme lecteur étranger chez Gallimard. En 1972, il devient critique littéraire au Nouvel Observateur. Il y restera quatorze ans, avant de rejoindre Le Monde des livres. Parallèlement, il obtient le prix Médicis étranger en 1977 pour Le Traité des saisons, et surtout le Femina, en 1985, pour son premier roman écrit en français, Sans la miséricorde du Christ.
” J’ai appris le français tout seul pour pouvoir lire les auteurs qui me fascinaient. Mais, lorsque j’ai dû écrire mes premier textes critiques pour Gallimard, j’ai découvert un sentiment qui ne m’a jamais quitté depuis: la peur. Peur de ne pas maîtriser assez le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire. Peur que mes notes de lecture soient mauvaises, que mes articles soient refusés. Elle est devenue plus forte depuis que j’ai été élu à l’Académie française. Faire une faute de syntaxe sous la coupole… un véritable cauchemar ! Mais le français s’est imposé, il m’appelait. C’était le début des années 80, j’étais en train d’écrire en espagnol un recueil de nouvelles: L’amour n’est pas aimé. Et je peinais … J’ai donc rédigé directement en français. Une amie m’a dit, alors, entre dépit et tristesse: “En français, ta prose n’a plus d’ombre.” Plus tard, elle est revenue sur ces paroles. En fait, j’étais pour tous un écrivain de langue espagnole qui désertait sa langue.
Il m’est désormais impossible d’écrire autrement qu’en français. Je suis fasciné par cette langue, par cet amour du style, du bien écrire qu’elle recèle. Le français aime les règles. Moi aussi, même si mon imaginaire est très éloigné d’un certain classicisme que je révère. Je suis d’accord avec Cioran, qui disait que, pour lui, roumain, adopter l’écriture française, c’était se passer une camisole de force. Seulement, il y a pour moi dans cette rigueur stylistique quelque chose qui me rassure, tout comme me rassure la belle symétrie d’un paysage. ”
(from Télérama, 22 janvier 1997)
© http://www.limbos.org/traverses/bianciotti2.htm
salut etienne, si tu me lis !!
Hector Bianciotti, l’élégant vagabond
ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 08.09.95
Pour l’enfant d’Argentine , l’arrivée en Europe fut le temps de la misère et de la faim. Quarante ans après, il en fait le récit.
Avec des clartés d’humour. Mais surtout une violence étouffée et un extrême raffinement
« Il suspendit son âme au clou du temps »
Hector Banciotti poursuit au pas lent de l’amour et au pas vif de la lucidité son voyage au long cours à l’intérieur de sa vie. Sur le chemin, il interroge, il s’interroge : « Les cris que l’on n’a pas poussés, où vont-ils ? »
Ces cris-là ne vont nulle part, nulle part ailleurs que dans les pages contenues d’une prose où la vie entrecroisée de l’écrivain s’impose seulement de ne jamais crier, si vive soit la douleur qui souvent l’étreint, si angoissante soit la détresse qui parfois le submerge. Enfant d’émigrants italiens ayant atterri dans la pampa, étouffant à Buenos Aires sous la dictature péroniste, fuyant l’Argentine pour se retrouver coincé sous la dictature franquiste, en proie à plusieurs difficultés d’être, dont celle de n’être évidemment pas doué pour l’hétérosexualité, déçu de ne plus pouvoir rester le séminariste qu’il crut devenir, imprégné, malgré ce qu’il nomme « l’inévidence de Dieu », d’un parfum de christianisme qui ne s’évapore pas, Bianciotti construit une oeuvre lentement et subtilement métissée. Sa culture italienne tisse avec son expérience sud-américaine, avec sa riche ressource castillane et avec son amoureux savoir de la langue française, une trame étonnante.
Le premier bonheur d’une vie qui a connu plusieurs souffrances, c’est pour notre ami la perpétuelle liberté à tire-d’aile d’une langue à l’autre, d’une syntaxe austère à un parler fluide, de l’Europe des caffone à l’Amérique des gauchos. Une des grâces d’Hector, c’est de pouvoir sentir, comme peu d’écrivains, la différence entre la tiédeur du nid de l’oiseau et l’espagnol pajaro, qui fend l’air comme une flèche. « Il m’est arrivé d’avancer que l’on peut se sentir désespéré dans une langue, et à peine triste dans une autre. »
L’extrême raffinement de Bianciotti, son sens de l’art et de la beauté naturellement naturelle ouvrent, à chaque pas de son voyage en lui-même, des clairières heureuses. C’est la vieille star du cinéma muet dans la bouche de qui « les voyelles battaient des ailes sur des lèvres fripées ». C’est l’admirable portrait de la Callas, dont « la voix flambait noir », et l’on aurait dit que « quelque chose en nous, d’informe, d’ignoré, attendait depuis l’enfance pour y couler sa peine ». C’est le passage d’un aventurier de la peinture, dont les inventions et les tentatives donnent un vertige gai. Il finira cependant par se donner la mort, en inscrivant un mot sur sa main. Est-ce le mot « fin » ? Est-ce le mot « non » ? Et Bianciotti résume en une ligne terrifiante ce départ sans retour : « Il suspendit son âme au clou du temps. »
Si le héros du récit était plus léger et frivole, on dirait de ses aventures, plutôt mésaventures, qu’elles sont « picaresques ». Mais de l’instant où il touche la terre d’Europe à Naples, les sourires de la vie se referment « comme un couteau à cran d’arrêt ». De petits métiers en expédients, après avoir été bouvier, enfant de choeur, il passe de la figuration de théâtre ou de cinéma aux fonctions de majordome des chats persans d’une riche artiste. Il n’obtient pas de visa en France, est contraint un moment de quitter l’Italie avant d’y revenir tirer le diable par la barbiche, et il devra demander à l’Espagne un asile précaire. Le maigre pécule qu’il avait en débarquant s’est épuisé.
Ici commencent des pages parmi les plus cruelles du livre, le cycle de la faim. De jour en jour plus sale, pas rasé, malade et malodorant, dormant sur les marches du grand escalier de pierre de la place d’Espagne à Rome, mangeant des racines de céleri sauvage dans les bois du Pincio, au-dessus de la villa Médicis, envertigé par la faim, il se décrit « si seul que j’aurais pu me dispenser d’être moi-même ». Epuisé par le jeûne, le manque de sommeil et de repos, il dit, exténué : « On ne sait pas comment on marche ni qui marche. » Le jour où il accepte d’un homme d’affaires belge un peu plus qu’une aide et beaucoup moins qu’une tentation, il est sauvé de la faim, mais constate que « l’âme a souvent horreur du corps ». Les pages d’Hector Bianciotti sur sa vie de 50 francs, son asphyxie par la détresse, son humiliation par la conjonction de la solitude avec la misère, sont à la fois d’une violence étouffée admirable et d’une finesse d’analyse inattendue. Que la dignité d’un homme puisse dépendre du vide de son estomac, de la crasse qui l’envahit, de la fatigue du sans-logis, des regards de mépris qui le croisent, on peut le deviner, si on n’a pas traversé soi-même l’expérience du clochard. Mais l’écrivain ici fait mieux : il fait sentir l’odeur atroce de la défaite, il fait vivre la petite mort de l’épave des rues, le marcheur dont tout le bien est à la consigne de la Stazione Termini, le passant qui sursaute en apercevant dans une vitrine le reflet d’un mendiant inconnu lui.
L’auteur de L’Amour n’est pas aimé est le roi des solitudes autant que le prince des amitiés la solitude des délaissés, l’amitié des malheureux qui se font la courte échelle pour échapper à leur déréliction. Il évoque avec la délicatesse d’un Proust des trottoirs les regards croisés qui l’encadrent, celui des policiers (« l’habitude de l’Argentin qui, sous Péron, regardait à droite et à gauche dans la rue »), celui des rôdeurs en quête de connivence, des vendeuses de leur misérable misère en quête d’acheteurs.
Cette descente aux enfers du délaissement, les beaux noirs de cette nuit angoissée laissent parfois passer une clarté d’humour. Il y a chemin faisant, sur les sentiers de la tristesse, des scènes de comédie, où le malheur garde les yeux secs et où l’ironie vise clair. Quand, à l’extrémité de la faim et de la faiblesse, Hector rassemble son courage et va frapper à la porte de la veuve d’un auteur dramatique dont il interprète les pièces dans des lectures publiques… La dame est sur le point de partir pour Venise. Elle n’a pas d’argent sur elle, tout est fermé dans la maison, prête pour son départ, et le bouquet de gardénias qu’un marchand des rues apitoyé a offert au visiteur famélique se fane déjà : « Au fait, dit la veuve, les fleurs, ce serait mieux que vous les repreniez. » La porte se referme sur le visiteur toujours affamé ! Il regarde le Tibre emporter sur ses eaux verdâtres les gardénias défaits. La veuve est déjà loin, délivrée de l’importun. « J’éprouvai de la honte pour elle », pense-t-il en s’éloignant. Il arrive à l’obélisque de la colonnade du Bernin, au Vatican, et s’écroule, avant d’aller mendier un morceau de pain à la soeur tourière des dames du Sacré-Coeur de la Trinita dei Monti.
Entre l’ironie et la souffrance, Hector aiguise avec malice les flèches d’un humour de guêpe. Le vagabond argentin développe au passage, avec un brio féroce, des malices sur l’Espagnol, l’éternel homo ibericus. « Il ne pense pas : il a déjà pensé. On a pensé pour lui depuis les siècles des siècles. » A un moment donné, le frère d’Hector a perdu sa trace et consulte une voyante. Elle lui apprend elle en est certaine que le disparu est mort. Quand, des années plus tard, de passage en Argentine, Hector rend visite à la voyante, il est chassé avec horreur : « Je ne veux pas de revenant chez moi ! »
Depuis qu’Hector Bianciotti a entrepris ces annales de la mélancolie, du désordre et de la lucidité, un leitmotiv en soutient les mouvements, la figure de la Mère, à laquelle l’écrivain a consacré ses plus belles, ses plus déchirantes pages une tendresse striée de remords, une reconnaissance sans faille, une dévotion jamais désarmée. Le secret de ces mémoires cruels et pénétrants, c’est que le visage de profil de la Mère éclaire celui du narrateur aux pires moments de désastre. Il participe, malgré toutes les batailles perdues d’une vie souvent chaotique et toujours rédimée, à une sagesse silencieuse. « Cette sagesse qui consistait à dispenser, sans la moindre effusion, l’amour qui n’attend pas de récompense. »
source: www.lemonde.fr
La nostalgie de la Maison de Dieu
de Hector Bianciotti

Poche: 151 pages
Editeur : Editions Gallimard (30 juin 2005)
Collection : Folio
Il y a longtemps, Borges me confiait que, d’un roman, il retenait trois scènes, trois passages, en tout et pour tout. Même à la relecture. Ce sont ces moments que j’ai essayé de fixer dans ce livre pour le réduire à l’essentiel, à la blessure des uns et des autres. A la question qui crie après tant d’expériences, et de voyages. Que faisait Dieu avant de créer le ciel et notre terre ? Le dieu qui se créa lui-même et prononça son nom dans un mur de silence, dans la lumière du soleil qui commence à rayonner, quand le rythme déjà devance la parole, et même les syllabes magiques ? Et l’amour ? L’amour qui ne compte pas les temps, qui n’a pas d’âge, qui va ici et là, et fait son travail de papillon… Mais la mémoire devient irréelle. Et si l’on avait confondu l’amour avec le désir - ou simplement aimé le désir ? H. B.
Seules les larmes seront comptées
de Hectore Bianciotti

Poche: 441 pages
Editeur : Gallimard (13 novembre 1991)
Collection : Folio
Parvenu à l’heure des bilans, le narrateur, directeur d’hôpital, se souvient que, trente ans auparavant, on avait exhibé devant les étudiants, dans un amphithéâtre déjà vétuste, aujourd’hui disparu, sa mère, presque mourante, un écriteau sur la poitrine.Et d’autres souvenirs reviennent qui font affleurer quelques figures d’Argentins : Gabriel, le kinésithérapeute aveugle, Nicolas, le frère, et même Eva Peron, haranguant du haut d’un tracteur une foule de miséreux. Mais très vite, sur la scène de la mémoire, c’est l’extravagant M. Moralès qui s’impose. Ancien grand couturier, tour à tour avide d’absolu et succombant à l’abjection, il entraîne dans son sillage un cortège d’excentriques.Seul le souvenir de sa mère, une femme aux yeux gris, pénétrée de la sagesse des humbles, revient apaiser le tumulte de la mémoire. Et les ombres, enfin, peuvent se dissiper.
Comme la trace de l’oiseau dans l’air
de Hector Bianciotti (Auteur)
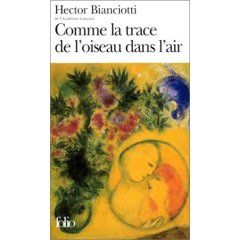
Poche
Editeur : Gallimard (27 février 2002)
Collection : Folio
Comme dans une fresque où la réalité se mêle au songe, Hector Bianciotti poursuit son Odyssée à travers l’espace et le temps. Est-ce l’heure du retour vers le pays de sa première naissance, vers la plaine argentine qu’un jeune homme aventureux avait quittée quarante ans plus tôt ? De ces jours étranges, comme de ces autres moments forts de la mémoire ressuscitée, l’auteur donne un récit que ponctue l’émotion et d’où naît une singulière fluidité de style. On croise au fil des pages des visages déchirés, renaissants, somptueux : Nilda la jeune fille mariée puis déchue, assassinée peut-être ; Hector Ramirez, ce double qu’on voudrait si proche et qui s’échappe de chapitre en chapitre ; Hervé Guibert, qui sait la mort à sa rencontre et qui écrit pour l’accueillir; Borges, le maître aveugle, l’ami. Bianciotti, l’homme aux mille facettes se fraie un chemin vers les régions magiques du passé, pour laisser la trace de l’oiseau dans l’air.
Sans la miséricorde du Christ
de Hector Bianciotti (Auteur)

Poche: 347 pages
Editeur : Gallimard (3 juin 1987)
Collection : Folio
«S’il y avait eu un autre témoin, je lui céderais volontiers la place, ici, pour qu’il mène à bien le récit de la vie d’Adélaïde Marèse, telle qu’elle me la laissa entrevoir au fil des quelques mois où nos exils coïncidèrent. (…) Je tâcherai de décrire le cheminement d’une femme depuis les jours de ce qu’elle appelait le continent austral (…) et qui est morte un dimanche, il y a quelques semaines, à Paris, dans l’une des nefs de l’hôpital Saint-Louis, après avoir vécu ses derniers mois dans le quartier du faubourg Saint-Denis où quelques personnes garderont, avant de s’en aller à leur tour, juste le souvenir de sa silhouette d’institutrice.»
|
Le pas si lent de l’amour
de Hector Bianciotti

Poche: 428 pages
Editeur : Gallimard (14 septembre 1999)
Collection : Folio
Le narrateur allait avoir vingt-cinq ans lorsqu’il quitta Buenos Aires, les poches vides, persuadé que son destin l’attendait en Europe et que, pour tenir debout, il lui fallait apprendre à tomber.A l’aube du 18 mars 1955, le paquebot atteignait le port de Naples. Au fil des pages, la mémoire ramène les aventures et les personnages de la plaine argentine où il est né. Hier serait-il toujours là ? Voici Naples, sa misère, sa joie de vivre, et son Christ voilé. Voici Rome bruissante de sa dolce vita, qu’il traverse en solitaire, sans moyens, affamé. Voici l’Espagne de Franco. Et, enfin, voici Paris où l’attend un autre voyage qu’il fera à son insu : le passage de sa langue d’enfance, l’espagnol, à la langue française…
|
Ce que la nuit raconte au jour
de Hector Bianciotti (Auteur)

Poche: 425 pages
Editeur : Gallimard (7 juin 2000)
Collection : Folio
Pour qu’il y eût ce livre, il a fallu d’abord deux continents, et que des Piémontais, poussés par la pauvreté, émigrent et aillent défricher un coin de cette plaine illimitée que l’on appelle pampa, où le centre du monde se déplace avec l’homme qui marche.Il a fallu aussi qu’un enfant promis, tout naturellement, aux travaux des champs, déjoue le plan de ses parents et saisisse la seule chance alors offerte aux gens de son état : le séminaire, où l’attendent, pêle-mêle, amitiés particulières, musique, les livres, qu’il espérait tant, et la découverte de la langue française. Il a douze ans. Là-bas, en Europe, la guerre bat son plein, tandis que, ici, s’installe et prospère la dictature, bientôt celle de Perón et d’Eva Duarte, sous laquelle nul n’échappe à la surveillance et à la délation.Et c’est le meilleur ami qui, se révélant soudain être un mouchard haut placé, et voulant se le faire pardonner, offre à l’ancien séminariste le billet de bateau salvateur. Alors commence pour le narrateur l’exil, les poches vides, mais, au cœur, la certitude que, dans la liberté retrouvée, la vie pourrait, comme pour tous, ressembler à un destin.
Presque quarante ans après son départ de l’Argentine, Hector Banciotti se souvient des premières vingt-cinq années qu’il a vécues dans son pays natal. Il est né, en 1930, le sixième de sept enfants d’une famille de paysans dont les parents avaient quittés le Piémont pour défricher la grande plaine argentine. Les premiers souvenirs de Hector Banciotti remontent à l’âge de six ans, lorsqu’il commence à découvrir son petit monde encore bien fermé. C’est avant tout la grand-tante Pinotta, une vieille femme bien étrange, qui exerce une grande fascination sur le petit garçon. En même temps, il décrit la vie simple et laborieuse de ses parents et de ses frères et soeurs mais aussi les quelques événements exceptionnels qui font sortir la famille de leur vie quotidienne. A l’âge de sept ans, le garçon devient le bouvier de la famille, et, initié par un autre garçon, il s’adonne, dans la solitude de la plaine, à jouir de sa sensualité. A cette époque de sa vie, il découvre également la musique et, à l’âge de neuf ans, il va pour la première fois au cinéma d’où il sort tout-à-fait émerveillé. Pour lui donner une éducation scolaire, ses parents l’envoient à Villa del Rosario chez les Salésiens. Contre la volonté de ses parents, le garçon décide d’entrer au séminaire où il peut poursuivre sa passion pour la littérature et la musique. Plus qu’une amitié ordinaire le lie à un autre séminariste. Mais reconnaissant qu’il ne peut pas se vouer à l’église, il quitte le séminaire à l’âge de dix-huit ans et retourne pour quelques mois chez ses parents. Dans la petite ville, il travaille comme employé de bureau. Restant ensuite quelques temps à Cordoba, où il fait partie d’un groupe de jeunes intellectuels, il gagne enfin Buenos Aires. Après les premières misères, il y vit le bonheur de l’amour, mais, de cette ville, il garde avant tout le souvenir de la peur. C’est la dictature péroniste qui intimide les gens, et le jeune homme doit découvrir que son meilleur ami est un des mouchards. Pour se faire pardonner, celui-ci lui procure un billet de bateau, et le départ pour l’Europe promet une nouvelle vie.
|
Auteur : Hector BIANCIOTTI
Titre:Ce que la nuit raconte au jour
Editeur:Le Livre de Poche, 9770
Année de parution:1994
Nombre de pages:274
Résumé
Presque quarante ans après son départ de l’Argentine, Hector Banciotti se souvient des premières vingt-cinq années qu’il a vécues dans son pays natal. Il est né, en 1930, le sixième de sept enfants d’une famille de paysans dont les parents avaient quittés le Piémont pour défricher la grande plaine argentine. Les premiers souvenirs de Hector Banciotti remontent à l’âge de six ans, lorsqu’il commence à découvrir son petit monde encore bien fermé. C’est avant tout la grand-tante Pinotta, une vieille femme bien étrange, qui exerce une grande fascination sur le petit garçon. En même temps, il décrit la vie simple et laborieuse de ses parents et de ses frères et soeurs mais aussi les quelques événements exceptionnels qui font sortir la famille de leur vie quotidienne. A l’âge de sept ans, le garçon devient le bouvier de la famille, et, initié par un autre garçon, il s’adonne, dans la solitude de la plaine, à jouir de sa sensualité. A cette époque de sa vie, il découvre également la musique et, à l’âge de neuf ans, il va pour la première fois au cinéma d’où il sort tout-à-fait émerveillé. Pour lui donner une éducation scolaire, ses parents l’envoient à Villa del Rosario chez les Salésiens. Contre la volonté de ses parents, le garçon décide d’entrer au séminaire où il peut poursuivre sa passion pour la littérature et la musique. Plus qu’une amitié ordinaire le lie à un autre séminariste. Mais reconnaissant qu’il ne peut pas se vouer à l’église, il quitte le séminaire à l’âge de dix-huit ans et retourne pour quelques mois chez ses parents. Dans la petite ville, il travaille comme employé de bureau. Restant ensuite quelques temps à Cordoba, où il fait partie d’un groupe de jeunes intellectuels, il gagne enfin Buenos Aires. Après les premières misères, il y vit le bonheur de l’amour, mais, de cette ville, il garde avant tout le souvenir de la peur. C’est la dictature péroniste qui intimide les gens, et le jeune homme doit découvrir que son meilleur ami est un des mouchards. Pour se faire pardonner, celui-ci lui procure un billet de bateau, et le départ pour l’Europe promet une nouvelle vie. Biographie Hector Bianciotti est né le 18 mars 1930, en Argentine, dans la plaine de la province de Cordoba. Ses parents étaient tous deux originaires du Piémont. Il fut séminariste, employé de bureau, publia des poèmes ici et là, et, passionné de théâtre , voulut s’y consacrer. Il quitta son pays en 1955. Il vécut à Rome et, ensuite, pendant quatre ans à Madrid. Il arriva à Paris en février 1961, travailla comme assistant pour des spectacles d’opéra. Et lecteur d’édition, il renoua vite avec la littérature. Il publia, traduit de l’espagnol par Françoise Rosset quatre romans et un recueil de nouvelles: chez Denoël, dans la collection “les Lettres Nouvelles”: Les Déserts dorés (1967); Celle qui voyage la nuit (1969); Ce moment qui s’achève (1972); chez Gallimard: Les autres, un soir d’été (théâtre, 1970) Le Traité des saisons (1977, Prix Medicis étranger) et L’Amour n’est pas aimé (1982, Prix du Meilleur Livre étranger). Dans ce recueil, une nouvelle était écrite directement en français. Chroniqueur littéraire, en français, à la Quinzaine littéraire d’abord, entre 1969 et 1975, et depuis 1972, au Nouvel Observateur, vers 1980, en dépit des efforts des efforts qu’il fit pour préserver sa langue maternelle, pour ses ouvrages de fiction, de manière insensible, il changea de langue. Aussi écrit-il en français depuis Sans la miséricorde du Christ (Gallimard 1985, Prix Femina). Chez le même éditeur, il a publié en 1989 Seules les larmes seront comptées. En décembre 1989, il renonça à ses fonctions d’attaché à la direction littéraire chez Gallimard pour devenir auteur et membre du comité de lecture des éditions Bernard Grasset. Depuis septembre 1986, il est chroniqueur littéraire au journal Le Monde. Ce que la nuit raconte au jour a obtenu le Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco. Hector Bianciotti a été élu membre de l’Académie française en 1996.
Extrait:
A l’âge de douze ans, le garçon entre au séminaire:
Lorsque, précédé de frère Salvador, je passai le seuil séparant le monde de la clôture, je crus que du plus haut le Ciel m’accordais la bienvenue: au moment où les lourds vantaux se refermaient derrière moi, et que les voûtes de la galerie à colonnes encadrant le jardin répondaient en écho à mes chaussures neuves, d’une cellule s’échappait, louée au piano, la musique que naguère, j’avais tenté de retenir, et dont la perte me chagrinait toujours. Je saurais, ce jour-là, qu’il s’agissait de l’andante de la sonate dite “au clair de lune”. Interloqué, frère Salvador, que j’interrogeais avec angoisse, de peur que la mélodie ne reparte à jamais, interrompit l’exécutant - qui deviendrait, bientôt, mon maître de solfège. Le père Rodriguez était un homme très grand et, de manière uniforme - sans abdomen en saillie à l’époque, ni double menton -, en apparence plus massif que gras. Des doigts aussi courtauds que les siens, au bout aussi large que les touches blanches du piano, je n’en avais jamais vu à la campagne où, les mains, outils ancestraux, souvent trop longues ou trop larges, ne se développent guère en proportion avec le corps. En fait le jeu au piano du Père consistait en un martèlement consciencieux qui, ses doigts manquant d’agilité, abattait les notes de manière très distincte; et même à l’harmonium, ses mais donnaient l’assaut au clavier en y mettant un poids superflu puisque l’intensité de la frappe ne saurait en rien renforcer les modestes possibilités de cet instrument au son gluant, plus d’accordéon que d’orgue. Or, ce jour-là, mon émotion et mon ignorance jouant de concert, dissimulé sous une solide opulence, le père Rodriguez fut le messager céleste qui, sans le soupçonner, me rendait l’un de mes tout premiers trésors. (…) Hector Bianciotti, Ce que la nuit raconte au jour
© http://mneia.org/biling/clf/f_auteur/f_bianc.htm
une video est disponible ici: http://www.babelio.com/auteur/Hector-Bianciotti/2698
|
|
Calendrier
Juin 2012
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|


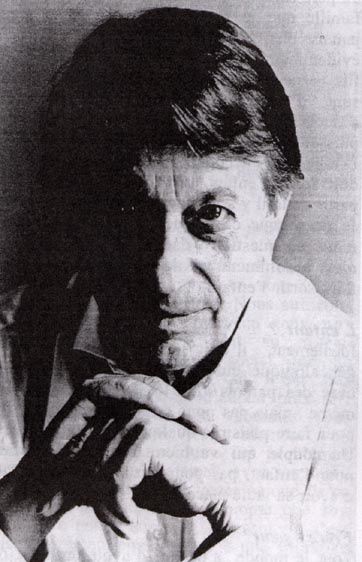


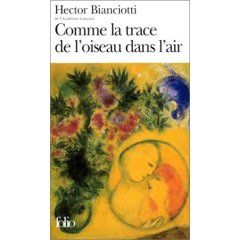



Derniers commentaires
→ plus de commentaires