|
Arnaldo Calveyra
[ARGENTINE] (Province d’Entre Ríos, 1929 — ). Fixé à Paris depuis 1961. Poète et dramaturge. « Ce campagnard égaré à Paris place toutes ses œuvres, qu'elles soient de théâtre ou de poésie, sous le signe de l'évocation et de l'invocation de la province natale. Les uns et les autres de ces écrits sont, comme toujours chez Calveyra, des textes de mouvance où rien n'est jamais acquis, ni les mots, ni le souvenir qui se cherche. » (Laure Guille-Bataillon, 1987).
Lettres pour que la joie
de arnaldo calveyra
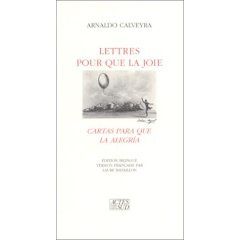
Broché: 59 pages
Editeur : Actes Sud; Édition : Ed. bilingue (8 janvier 1992)
Collection : Poesie
Dans le neuvième texte de ce recueil on peut lire : " Un matin elle me trouva pleurant et je tournai le dos pour qu'elle ne vît pas ce que je pleurais. " Cet infime décalage syntaxique est caractéristique des traverses par lesquelles Arnaldo Calveyra introduit le lecteur à l'espace poétique situé entre les mots et les choses. C'est dire la vulnérabilité de sa prose et la nécessité d'en faire une lecture parlée (voix haute ou voix silencieuse, au choix), sous peine d'écraser la subtile déférence des phrases pour la mémoire. L'exigence requise est d'ailleurs d'entrée de jeu signalée par celle de la traduction, en vérité une transposition à laquelle Laure Bataillon a consacré de longs soins. Pénétrés de sa magie, nous avons, nous aussi, édité ce livre " pour que la joie... ", et en version bilingue " para que la alegría... ".
L'origine de la lumière
de Arnaldo Calveyra (Auteur)
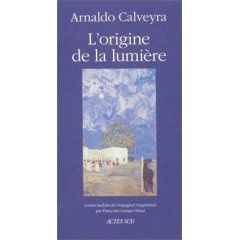
Broché: 153 pages
Editeur : Actes Sud (10 août 1993)
Collection : Lettres latino-américaines
Onze contes poétiques qui participent de la vision enfantine avec les sensations et les angoisses qui hésitent entre le rêve et le réel.
Extrait de L’origine de la lumière:
Arnaldo CALVEYRA L'origine de la lumière
Dans l’année, il y avait un jour — c’était une date mobile qui s’amusait à se déplacer d’une semaine ou deux — un jour que l’on appelait le jour de l’ouragan ; et c’est en pleine connaissance de cause qu’on le nommait ainsi car il faisait partie de l’héritage laissé à la mort de quelqu’un au même titre que les casseroles, les bouilloires, les chaises ou les chiens de la maison. Certains allaient même jusqu’à évoquer des événements personnels, deuils, mariages, paiement d’une dette, perte d’un troupeau de chevaux, etc., en le prenant comme point de repère chronologique. Du coup, le jour de l’ouragan rivalisait avec l’avènement du Christ.
Il pouvait, je l’ai dit, être en retard ou en avance mais, comme un cheval encore sauvage que l’on oblige à se mettre en piste avant le début de la course, nous le savions à l’affût dès qu’approchaient les fêtes de fin d’année, et s’emplissant peu à peu de la terrible force qu’il déchaînerait en son temps. Son travail sournois, nous le sentions dans nos corps déliquescents qui, avant d’entreprendre la moindre tâche, cherchaient à s’affaler sur le premier siège venu.
Certains oiseaux, ces jours-là, alertés par l’imminence d’on ne sait quel événement extraordinaire, cessaient de fréquenter le ciel de la maison et s’en allaient chercher refuge en des lieux ignorés de nous. Pourtant, fait qui jamais ne se répéta, à la veille d’une de ces tempêtes apparut un pigeon voyageur. Epuisé, petit astre blanc tout fiévreux, il vint se poser dans un des patios. Les premiers secours ne tardèrent pas à s’organiser. Il avait une bague à la patte, qui cachait probablement un message. Nous lui donnâmes à boire et laissâmes quelques graines à sa portée. Nous nous disions que le tremblement de ses ailes, cette fièvre l’achèveraient, et nous l’installâmes dans un endroit frais, hors d’atteinte de la curiosité des chiens. Trois ou quatre jours passèrent. Environné par une fraîcheur de ruisseau, le pigeon survécut. Il recommença à s’alimenter et le lendemain de l’ouragan réussit à reprendre son vol.
Autre signe précurseur : la netteté persistante qui gagnait la rondeur du ciel et tout ce qui s’y reflétait : maisons, branches, végétation. Immuable, imperturbable, l’ouragan s’emparait de l’horizon, s’y installait, s’y maintenait, y durait. Sans parler des animaux qui recherchaient le moindre recoin d’ombre, le plus léger soupçon de feuillage.
L’ouragan dont je me souviens nous avait envoyé des signes avant-coureurs grâce au très délicat ouvrage d’une araignée, une toile qui s’obstinait depuis plusieurs semaines dans sa perfection et dont, chaque matin au lever, nous pouvions admirer la splendeur encore chargée de deux ou trois gouttes de rosée luisant au soleil. Fierté d’un des casuarinas de l’entrée, cette toile, mystérieusement, fut détruite. Enfin, indice encore plus digne de foi : ce soir-là, à la nuit tombante, l’horizon ne fut pas touché par l’ombre, la lumière ne se modifia pas, ne s’éteignit pas, ne l’abandonna que très tard.
Nous le guettions depuis une bonne semaine. Mais à force de l’attendre et de le voir chaque fois se dissiper à l’horizon, nous finîmes par acquérir la certitude qu’il nous trouverait, comme presque tous les ans, endormis… un ouragan qui abattit des arbres, démolit des moulins, déchiqueta le bétail, démantela granges et silos ; le four à pain lui-même, si protégé, si oublié dans son petit creux de paradis, se vit forcé de sacrifier quelques-unes de ses briques à ce dieu sans foi ni loi.
Notre corps, cet assemblage d’eau et d’âme, pesait des tonnes sous nos vêtements et les travaux que nous dûmes entreprendre cet après-midi-là nous semblèrent dignes d’Hercule ; nous courions aussi vite que possible d’une ombre à l’autre ; le bouclier de nos chapeaux s’avérait impuissant à nous protéger des tenailles incandescentes du soleil ; les mouiller en passant devant un robinet s’avérait inutile, il nous fallait chaque fois inventer une nouvelle stratégie pour regagner bien vite les endroits où il y avait de l’ombre : mur, arbre, treille, avec toujours la même envie de défier ce soleil qui se prenait tellement au sérieux.
L’été, il nous arrivait, l’après-midi, d’attendre avec nos éventails — cadeaux de fin d’année des commerçants du bourg, ornés de photos d’actrices ou d’acteurs de cinéma nord-américains —, que la chaleur veuille bien céder, ne serait-ce que de quelques pouces. Mais ce jour-là, ce fut en vain que nous guettâmes le plus léger des signaux, l’apparition d’une brise, si modeste fût-elle ou une preuve plus ou moins manifeste de la fusion du jour dans la nuit. Nous ressemblions à des comédiens épuisés sur une scène que l’éclairagiste aurait quittée en oubliant d’éteindre les projecteurs.
Dans cette obscurité qui n’en finissait pas de s’installer, nous pouvions entendre, au-dessus de nos têtes, l’agitation erratique des oiseaux, leurs déplacements de branche en branche ; ils se chamaillaient, aussi déroutés que nous en bas, insomnieux dans la profondeur plus ou moins retrouvée du patio ; et puis, de nouveau un froissement d’ailes, un abri que l’on abandonnait, le besoin de partir à la recherche d’un buisson lointain.
Enfin, quelque chose que l’on pourrait assimiler aux prémices d’un crépuscule commença à rôder autour de nous, à cerner nos masques blafards.
Devant l’absence de brise amicale, dans cette fixité torride qui semblait nous renvoyer à une lueur de lever du jour, nous allâmes nous asseoir sous la tonnelle pour le dîner. Il y avait, je crois, des gens de Buenos Aires. J’ai oublié leur conversation, tout emplie sans doute de points de suspension. Subitement, au milieu d’un silence de plomb, nous perçûmes nettement que les cimes des casuarinas se mettaient à l’écoute, tendues, comme à l’affût d’un brusque déplacement de troupeaux là-bas, avant d’entrer presque aussitôt en un jeu désespéré de questions et de réponses, un jeu apparemment sans issue, à en juger par sa mise en route circonspecte.
Ce fut d’abord comme si des centaines d’oiseaux se réveillaient sur ces branches qui, brusquement, nous parurent étrangères, ou comme si oiseaux et branches, sur la défensive et pour tenter de conjurer un malheur en suspens dans l’air, perdaient d’un coup toute identité. Car déjà ils s’essayaient à un chant qui, à l’évidence, leur était totalement inconnu (à moins que la terreur, et la terreur seule, ne les aidât à trouver la note suivante de cette lugubre mélodie). Mais nous, nous savions que cette chanson ressemblait, autant qu’une goutte d’eau à une autre, au prélude de l’ouragan de l’année précédente, un ouragan, soit dit en passant, qui planait maintenant au-dessus de nos têtes.
L’espace entre les casuarinas fut occupé par un sifflement aussi aigu que le rugissement d’une cataracte gigantesque qui se serait précipitée de hauteurs jamais imaginées par aucun conquistador. Ce sifflement, bien que nulle mémoire ne l’eût jamais enregistré, semblait vouloir attirer — tel un faucon lanier au fin fond des fourrés — des oiseaux que nous n’avions jamais vus, tandis que ceux qui s’estompaient au-dessus de nos têtes s’employaient, en une basse continue, à narguer la masse que formait la nuit et que ce bramement nous chassait de nos sièges, gagnait en fureur et se déplaçait le long d’une falaise qui n’était autre — nous nous en rendions enfin compte — que les frondaisons des arbres.
Il arrivait en tourbillonnant, et de si loin que personne n’aurait pu lui poser la moindre question. Après que le premier coup de fouet eut lacéré le ciel, vint le tour de la tonnelle qui parut entrer dans le poing d’un géant, s’agita, se secoua, comme si, dans la confusion générale, quelqu’un l’avait prise pour un poirier chargé de fruits mûrs, ou comme si l’on cherchait à l’arracher du sol, elle, les piquets, les plantes, les clous, les grillages, et nous avec, tandis que le premier tremblement de terre s’attardait entre nos bras et que les assiettes se couvraient de pétales de roses — les roses préférées de tante Adelina, que l’on appelait les sept sœurs — et qui cette nuit seraient le mets de prédilection du vent.
La rafale de vent — le vent dans toute son ampleur, tous les vents à la fois — prenait à présent une consistance liquide, montait de plus en plus au-dessus de nos têtes, englobait la masse entremêlée des arbres et continuait à s’élever en tire-bouchon, jusqu’à s’emparer du ciel tout entier.
C’est alors qu’un lambeau de ce vent sembla se détacher des grands eucalyptus du jardin, perdre momentanément de sa vitesse et se retrouver, vibrant, entre nos bras, qu’il força à décrire d’incohérents signaux dans le vide.
La tornade cependant continuait à ramasser tout ce qu’elle trouvait sur son passage. Dans la panique, les lanternes avaient été rentrées, toutes les lampes précipitamment éteintes afin d’éviter les incendies ; une voix féminine (tante Adelina, ma mère ou l’une de mes sœurs ?) nous appelait de l’intérieur, pour nous soustraire aux éléments, au lieu sans frontière où nous nous attardions, tandis que déjà la roue du moulin, libérée de son frein, tournait comme une folle et s’engageait dans une course contre le cyclone. Les arbres les plus éloignés de la maison, ceux qui nous servaient de lien avec la vastitude des champs, étaient passés de la pleine terre à la pleine mer.
Et comme quelqu’un que l’on croit simplement ivre mais qui devient fou au milieu de la nuit, cet abysse était en vérité fou lui aussi, lame déferlant sur le bétail pour le sortir de sa torpeur, déplaçant les chevaux dans les prés comme s’ils étaient pourvus d’ailes, oui, et fous les vents (combien pouvait-il y en avoir ?) qu’il renfermait sans doute dans ses profondeurs et qui pouvaient maintenant tout renverser sur leur passage, nous entraînant au fond des eaux pour nous faire goûter de leur terrifiant prestige.
Enfin, comme une farce soigneusement préparée pour l’heure du dîner mais trop tôt dévoilée, le vent, dont l’intensité semblait avoir décru, fit un petit tour avant de revenir, métamorphosé en ouragan, tandis que la nuit s’emparait du patio tout entier.
Malgré les appels pressants des femmes, c’était merveilleux — ce le serait aujourd’hui encore — de rester dehors, les bras chargés de tempête, de rester dans le noir absolu, dans l’exubérance de la tourmente, devant ce seuil inconnu tout empli de tumulte et traversé seulement par quelques éclairs dont la tâche visible était d’amener la pluie ; de respirer l’odeur que prenait la terre cernée par une unique pensée, par un événement digne d’être relaté, alors qu’il n’y avait plus trace de la moindre lanterne, et que les fenêtres, fermées depuis longtemps, faisaient stoïquement front à l’attaque furieuse, oui, merveilleux d’être dehors jusqu’à ce que surviennent les grondements de tonnerre et qu’en se perdant au loin ils annoncent les premières gouttes de la pluie tant attendue qui, en un tournemain, inondait les conduites d’eau et semblait surgie de terre plutôt que tombée du ciel.
© http://www.actes-sud.fr/
Le lit d'Aurelia
de Arnaldo Calveyra (Auteur)
Broché: 148 pages Editeur :
Actes Sud (10 août 1993)
“Quand Amadeo Donadieu partit avec une autre femme, me laissant prête pour la noce, ma sœur Ermelinda m’annonça la nouvelle un matin très tôt avant que je me lève. Je suis restée clouée au lit – jusqu’au soir pensais-je – par une forte douleur dans les jambes, puis tout le jour suivant, espérant trouver un soulagement à ma peine. Et ainsi de suite/ trente-six ans au lit (si mes comptes sont exacts), entre deux morts comme un plongeur entre deux eaux.” Ainsi s’exprime Aurelia dans l’épitaphe (elle en a la manie) qu’elle dicte à l’une de ses sœurs avant de mourir.
On a aura compris que le récit d’Arnaldo Calveyra – Le Lit d’Aurelia – est en vérité une fable. Mais qu’elle fable que le poète argentin a composée avec cette sorte de lyrisme subtil qui ancre le rêve dans la réalité (à moins que ce ne soit l’inverse) ! Ce récit de la déréliction et du refus – car c’est sa vieillesse qu’en se mettant qu lit la jeune Aurelia a décidé d’attendre – se déploie en effet tel un paysage dont l’immobilité est transformée par la quotidienne alternance du clair et de l’obscur. De telle sorte que la si lente mort d’Aurelia demeure, la dernière page tournée, comme un chant de vie et de passion.
HUBERT NYSSEN
extrait:
Arnaldo CALVEYRA
Le lit d'Aurélia
Cela faisait un moment déjà que dans le village — un bourg poussiéreux de quelque mille âmes — le bruit courait d’une femme encore jeune qui avait pris le lit sans présenter le moindre signe de maladie. Tout avait commencé, semblait-il, un matin où, sans crier gare, elle avait décidé de ne pas se lever. Quand la nouvelle passa de bouche en bouche, les gens du village, pourtant enclins d’habitude à l’étonnement, pensèrent d’abord qu’Aurelia Campodónico — car tel était le nom de cette femme — soignait tout simplement une maladie exigeant que l’on gardât le lit. Et ce manque d’étonnement — il est vrai que son cas était sans précédent — finit par devenir un symptôme de plus — et non le moins mystérieux — de sa maladie.
Il ne manqua point cependant, et dès le début, de personnes bien intentionnées pour soutenir qu’Aurelia n’était qu’une intrigante voulant faire parler d’elle à tout prix. Et qu’un beau jour elle se relèverait aussi soudainement qu’elle s’était couchée. Et qu’elle aurait aussi bien pu crier à une apparition de la Vierge Marie, patronne du village, dans la cour de sa maison.
Le docteur Ramirez, médecin de l’endroit, n’arrivait pas à lui trouver, malgré ses nombreuses visites — religieusement payées — quoi que ce fût d’inquiétant et ses pressantes objurgations pour que sa patiente se relevât restaient sans effet. Mais à mesure que passaient les jours et devant l’acharnement de cette femme à ne pas quitter le lit, on en vint peu à peu à se dire que s’il y avait bien maladie, ce devait être la plus redoutable de toutes, la maladie d’amour.
Oui, il fallait se rendre à l’évidence. Ce qui ne désarmait pas dans le fond les sceptiques incorruptibles. Mais à présent même les plus récalcitrants commençaient à se taire quand on abordait le cas d’Aurelia. Aurelia aurait été marquée de ce stigmate que certains considéraient comme hautement contagieux. Se mirent à circuler les versions les plus échevelées sur les façons dont ce mal l’aurait atteinte, mais ces commérages eux aussi finirent par retomber comme la poussière avec la pluie tant attendue, ouvrant ainsi la voie — l’horreur du vide dans nos villages est chose digne de considération — à une rumeur incroyable : Aurelia aurait été abandonnée par son fiancé juste quelques semaines avant son mariage et dès que la moindre occasion se présentait, les gens, avec leur tempérament de journalistes, interrogeaient les deux sœurs d’Aurelia mais il semblait hélas qu’elles n’en savaient pas plus long qu’eux. Cette rumeur nouvelle prit bientôt son essor, se suspendit aux balustres des plus hautes terrasses et fit les gros titres du journal oral du village. Mais là encore, quelle était la part de la réalité et celle de la fantaisie ? Certes, Aurelia possédait un trousseau considérable, entièrement, ou presque, cousu de sa main comme il était alors d’usage. Même sans l’avoir vu, personne — tant soit peu de bonne foi — ne pouvait en nier l’existence. Un trousseau qui obéissait aux normes en vigueur à l’époque : deux douzaines au moins de draps de milieu, ourlés et brodés pendant des mois et des années, souvent sans autre compagnie que la lampe à pétrole ; sans compter une infinité d’autres pièces de linge de maison. Mais quelle jeune fille ne courait pas acheter, dès qu’elle avait un peu d’argent tiré de la vente de quelques œufs, poules ou dindons, des mètres et des mètres de tissus à la meilleure boutique du village afin de se livrer à la confection du peut-être illusoire trousseau ?
Aux premiers temps de sa décision singulière, Aurelia ne voulut pas recevoir d’autres visites que celles du docteur Ramirez et comme ses deux sœurs, à qui elle avait refusé toute explication, laissaient paraître une ignorance éplorée, "nous sommes pires que des ouvrières à la journée, Aurelia ne nous dit jamais rien", la rumeur publique se vit dans l’obligation de s’en tenir dramatiquement et pour un temps indéterminé à la version de la femme abandonnée par son fiancé aux portes mêmes de l’église.
Il est vrai que l’ignorance où Aurelia tenait ses sœurs paraissait à certains bien improbable, mauvaise foi des sœurs elles-mêmes. Quoi qu’il en soit, à cette femme au lit, il fallut procurer le nécessaire à sa subsistance, à commencer par le déjeuner du matin : maté sucré avec biscuits, à moins que ce ne fût des oreillettes si la veille avait été jour de pluie.
Aux bals du club "Tiens-moi le bébé" — qui devait son nom à ce que les filles invitées étaient pour la plupart filles mères et demandaient à leur voisine de chaise de garder leur bébé le temps d’une danse — on ne manquait aucune occasion, surtout aux premiers temps de la maladie d’Aurelia, de commenter ce qui la retenait au lit.
– Et avec ces chaleurs, pensez donc ! Déjà qu’on a du mal à supporter le drap quand on est bien portant, à plus forte raison quand on est malade, et par-dessus le marché, matin midi et soir ! Il n’y a pas d’éventail qui tienne en pareilles circonstances !
– Un si bon élément pour nos bals ! Quel dommage !
– Moi je trouve que c’est surtout à la valse qu’elle était imbattable. Personne ne lui venait à la cheville pour ce qui est de la virevolte fleurie.
– Et la fois où elle est montée sur une chaise, là, et où elle nous a chanté : Non, non, jamais je n’oublierai.
– Et la fois où cet étranger si bien habillé est venu l’inviter pour un tango et où les musiciens se sont trompés et ont attaqué une valse ? Et l’étranger qui lui a dit : "Putain de sort, mademoiselle, c’est bien ma veine, ils nous donnent une valse au lieu du tango." Le spectacle que ç’aurait été avec un couple pareil !
– Oui, une cavalière hors classe, tout le monde voulait danser avec elle.
– Et les pas de côté au tango qu’elle faisait aussi bien que sur les photos ?
– Oui mais c’était surtout pour la valse qu’elle était sans rivale, comme on dit. Quand elle s’y mettait, la salle entière commençait à tourner, murs y compris, et soi-même il fallait qu’on s’accroche à la table. Et elle, comme si de rien n’était, toujours fraîche comme une rose.
– Il paraît que ça la repose, de tourner.
– Que ça la reposait…
– Ça finira bien par lui passer cette lubie, ça doit être juste un peu de neurasthénie, la pauvre.
Le temps passait et les racontars, en longeant la maison des sœurs Campodónico, s’évanouissaient dans les airs. Mais ces conversations n’arrivaient pas alors jusqu’à la chambre d’Aurelia, ses sœurs veillaient. La seule chose qui était une nouvelle de source sûre c’était qu’Aurelia peu à peu s’habituait à son lit. Mais si les informations sûres manquaient, au fond quelle importance ? A peine un commérage avait-il expiré à l’usage que d’autres se lançaient à l’assaut d’une possible carrière. Car il y avait aussi les éphémères, les mort-nés, les impossibles, jamais on ne pouvait détecter leur source réelle, ils arrivaient en nuées d’orage pour s’abattre sur le plexus dramatique du village.
Selon un dicton fort respecté de tous, qui se tait une fois risque fort de se taire à jamais. De là la masse d’interprétations sur ce cas exceptionnel, boules de feu lancées à l’aveuglette aux quatre coins de la rose des vents, échafaudages le plus souvent extravagants, incohérents, manquant de cet élémentaire sens commun indispensable à la lente élaboration d’un mythe ; mais peu importait, on trouvait toujours la personne disposée à en supporter la vraisemblance et, en dernier recours, à compenser ses carences par de nouvelles erreurs.
Il faut dire qu’une femme au lit sans être le moins du monde malade est un sujet en or. On devait donc se consacrer à en tirer le maximum de profit. Ainsi quelqu’un alla jusqu’à imaginer qu’Aurelia s’était alitée pour faire parler d’elle dans le feuilleton de quinze heures à Radio Belgrano et qu’à cette fin quelqu’un (un autre quelqu’un, toujours quelqu’un) avait écrit sur sa demande à Néné Cascallar, la scénariste bien connue des feuilletons radio, afin que, se basant sur ce triste sort, elle imaginât un roman qui ferait d’Aurelia, femme dédaignée dans la vie réelle, une célèbre héroïne de radio.
Les gens se saisissaient de son cas comme d’un jouet flambant neuf chargé de mille possibilités. Surtout les hommes mûrs qui se croyaient à l’abri des morsures d’amour. Alors dans les buvettes, entre deux verres et deux parties de cartes, abondaient les inventeurs de nouveaux chapitres, ou encore ceux qui poussaient la porte avec à la bouche la dernière nouvelle sur le cas.
Dans les vers improvisés annonçant les cartes qu’on avait en main, au truco, on citait Aurelia et son lit, objets complices, vaguement érotiques, le tout assaisonné de quelques pincées d’indécence. Les personnes qui trouvaient là motif à rire ou à sourire étaient moins rares qu’on ne croit. Enhardies par la durée inusitée de cette réclusion, elles affirmaient avoir fait la liste des maladies les plus anciennes dont on aurait pu rapprocher ce cas. Car enfin, à cette époque, les plus graves maladies n’avaient jamais dépassé trois mois de lit.
Et du côté des femmes il y avait les ex-rivales d’Aurelia qui pensaient — et déclaraient sans ambages — que ce n’était que simagrées de sa part pour reconquérir à tout prix — ou même conquérir — l’amour d’un homme qu’elle avait perdu à cause de son peu de beauté. Certes, les jeunes filles accortes ne manquaient pas dans le voisinage et si les concours de beauté avaient existé comme aux Etats-Unis, plus d’une, entre seize et dix-huit ans, aurait pu prétendre à un titre.
Pour ce qui est d’Aurelia, il faut bien dire qu’on n’allait jamais pouvoir tirer au clair cette histoire si souvent invoquée, de fiançailles rompues. Tous les amis du fiancé supposé étaient clairs et nets là-dessus : ils invoquaient en sa faveur sa condition de poète, c’est-à-dire d’amoureux des muses, être éminemment célibataire (dans la foulée, ils étendaient cette condition de célibat à toute personne ayant un amour immodéré des livres). Ils pensaient donc impossible qu’il ait jamais pu, poète comme il était, songer à abandonner son amour profond de la solitude, cet état de disponibilité totale que lui, dans son langage si particulier, appelait "la divine jouissance".
Aurelia avait-elle senti qu’elle perdait ses dernières chances d’être une femme mariée et comprit-elle que c’était la seule possibilité qu’elle avait de ne pas devenir un pilier de sacristie comme ses sœurs ?
Demeurer au lit, était-ce une astuce, une manière de chantage ?
Dans leur course obstinée vers la boutique de linge plutôt que vers l’amour, combien de jeunes filles plus avantagées qu’elle n’étaient-elles pas restées en rade ? Comment faire pour que le trousseau préparé avec tant d’illusions pendant tant d’années en vînt à coïncider avec la réalité du mariage ?
Encore une fois, au café-buvette — lieu des hommes par excellence — il ne manquait pas de gens pour dire qu’il y avait des femmes, surtout parmi les "plus tant jeunes" (mais considérons qu’à cette époque on disait d’une femme de plus de vingt ans qu’elle "ne serait pas cuite au premier bouillon") qui prenaient pour argent comptant les deux ou trois galanteries d’usage que leur débitait au bal celui qui les invitait à danser. Elles se considéraient vite de la tête aux pieds comme les élues de l’Amour et ce qui est plus grave, comme l’élue d’un tel ou d’un tel. Mi-badins, mi-sérieux, les hommes affirmaient qu’il y a beaucoup d’affabulation dans les propos d’une femme qui court le risque de rester célibataire. Bien des jeunes filles s’étaient vues dans l’obligation de tomber amoureuses rien que parce qu’elles étaient "filles à marier" mais aucune, il est vrai, n’avait dû recourir à cette extrémité de "prendre le lit" pour mener à bien leur campagne ; le cas d’Aurelia était un cas limite en la matière, si tout ce qu’on disait sur elle était vrai.
En ce temps-là — deux ou trois hivers étaient arrivés et avaient passé leur chemin depuis qu’Aurelia s’était mise au lit —, la chambre de l’Alitée, dans cette deuxième étape de sa "maladie", s’ouvrit peu à peu aux visites, peut-être en contrepartie des conversations des cafés et buvettes, alors inexpugnables parce que hermétiques. La recluse voulait savoir personnellement ce qui se passait dans le monde. Peu à peu sa chambre devint la rédaction d’un second journal oral : nouvelles, supputations, contestations y circulèrent librement et, à coup sûr, en grande quantité, des médisances de rechange.
Etrange. Juste au moment où la chambre d’Aurelia s’ouvrait aux visites, le bruit courut à nouveau dans le village (oh ! juste le temps d’un cycle lunaire) le bruit tant de fois accepté et tant de fois rejeté que sa maladie était contagieuse. Ce qui n’empêcha pas les curieux, qui se comptaient par dizaines et attendaient depuis longtemps l’occasion, de se précipiter dans cette chambre couleur de sable pour — enfin ! — se trouver en présence de l’intéressée et constater de visu les ravages que la mystérieuse maladie avait dû faire sur son visage.
Etrange en effet : à présent que la porte d’Aurelia s’ouvrait, personne ne trouvait plus dangereux de la franchir. On finit par compter par centaines les visites de ces premiers mois, il n’y avait jamais assez de maté pour régaler ceux qui se dérangeaient, les deux sœurs debout, étourdies par tant de visages, étaient ravies au fond, après cette pause conventuelle, de voir qu’avec ces visites passant de pièce en pièce un air de fête cherchait à entrer et à prendre ses quartiers dans la maison. C’était, finalement, comme si tout le village courait se suicider dans cette chambre si éprouvée. On enregistra même, par la suite, le cas de quelques jeunes filles qui gardèrent le lit plus que de raison mais leurs proches les déclarèrent sans exception "grippées", et l’une après l’autre, passé le plus fort de la morsure d’amour, elles finirent par abandonner le lit.
© http://www.actes-sud.fr/
Si l'argentine est un roman
de Arnaldo Calveyra (Auteur)
Editeur(s) : Actes Sud
Genre : ROMAN CONTEMPORAIN
Date de Parution : 04/06/1999
Texte d'origine argentine traduit par Claude Bleton
Présentation : Broché - 204 pages
"L’Argentine, un pays fictif ? Comme un personnage de roman qui commencerait par se montrer aux yeux du lecteur, qui l’accompagnerait pendant quelques pages pour disparaître au moment de refermer le livre, ou bien, comme dans certains cas, pour continuer de vivre dans l’imagination du lecteur."
Si l’Argentine est un roman, si elle est un personnage qui s’abandonne à la fabulation de son histoire inventée, à l’évanescence de son présent fictif, aux résurgences endémiques de sa crise morale, alors il faut, pour en saisir les contours affectifs, chercher un chemin entre essai et méditation, poésie et géopolitique, philosophie et psychopathologie sociale. Telle est l’entreprise — sans concession mais fervente — à laquelle se livre un écrivain de l’exil dont les brefs retours au pays, toujours bruissants de mémoire, et par là lumineux et douloureux, furent comme la surimpression de ce qu’il voyait ou savait déjà, et de ce que ses compatriotes s’imaginaient être. De cette étude de caractère est né un texte singulier, soumis aux vents changeants de l’humeur, aux variations climatiques de l’âme, dont la langue aérienne et paradoxalement si précise estompe les idées reçues, contourne les lieux communs, pour déchiffrer l’empreinte de l’inconscient collectif, et révéler avec une rare acuité le filigrane du portrait national…
Calveyra, page à page
Article paru dans l'édition du 25.09.98
Deux livres de l'écrivain argentin : version douce, le poème du souvenir ; en cruauté contrôlée, une méditation poétique sur son pays
Arnaldo Calveyra, Argentin de Paris, « Argentin impénitent », publie deux livres ensemble. L'un, L'Homme du Luxembourg, est un poème présenté en version bilingue. C'est le livre d'« un homme habitué à déambuler à travers la ville, à cheminer comme cheminent ceux qui vont quelque part ». Les pas de l'homme sont les pages du livre. On peut apprendre l'espagnol d'Argentine du marcheur par ce poème : il y a les mots, les tournures et surtout la musique de l'inconnu que rend la traduction. L'autre livre, dont celui-ci est le dictionnaire intime, Si l'Argentine est un roman, se présente comme un montage. On apprend l'Argentine, sa géographie politique, son histoire littéraire, par ce livre qui y prétend le moins. Il en dit plus qu'un traité, qu'un essai. Avec plus de cruauté : sur la physiologie du tortionnaire, par exemple. Pourquoi ? La langue. Et la langue fondée sur quoi ? Sur ce point : « Il n'est d'éternel que le désir. »
Ces deux textes font enfin découvrir Arnaldo Calveyra en Espagne. Il est d'usage de les traiter séparément, l'un avec plus de patience raisonnée que l'autre (le poème). C'est la sagesse même. Le « hic », c'est qu'à la lumière de Borges et au plus près de la méthode de Calveyra, ils vont ensemble l'amble de leur pas de livre. Ils vont ensemble différemment. « Pour en finir une fois pour toutes avec l'intrigue : un homme dans une chambre d'hôtel (l'intrigue de ce livre est un homme assis devant une table dans une chambre d'hôtel), c'est le narrateur de ce livre. Nous savons qu'il est originaire de Buenos Aires. »
Cet homme est inventé, nous-mêmes le sommes passablement, et le jet d'eau de la fontaine Médicis du Luxembourg, pas moins. A la source, ce jet dont le poème donne l'extraordinaire variation ; en aval, l'adresse à qui voudra bien lire, d'une lettre ou d'une rumeur, comme on écrirait à la soeur disparue. Ce qui glisse de l'un à l'autre (l'entre deux livres), c'est la peau du souvenir. Le temps change les marcheurs en brouillon du souvenir. Celui du Luxembourg s'arrête net devant eux comme un cheval au galop, la nuit, qui pressent un fantôme. Il va par les sentiers, heureux comme avec une femme, « la fontaine tourne son film, allées, bande-son du silence. Ombilic de quelques roses ».
De cette histoire de l'Argentine, déchirée, pathologique, d'abord coloniale et qui le reste, « les uns colons des autres, colons de nous-mêmes », de cette histoire née pour prendre une tournure de sage-femme « par le cul », il faut confier la rédaction méditée aux poètes, à l'homme du jardin du Luxembourg. Il y a ici une perfection de regard qui est celle de la langue : sur la dictature, les tremblements de corps, le cheval et la figure du tortionnaire ; sur les autobus et leur attente (scène magistrale, comme une scène de Brecht, une image de Hopper, un conte de Thomas Bernhard), sur les Malouines, sur ces morts de jeunesse qu'il a fallu consentir loin, dans des îles frigorifiées, pour reconquérir la démocratie ; sur le rôle des poètes et des intellectuels, sur le consentement, sur ces thèmes épuisés comme de vieux tangos... Les tout premiers tangos sont déjà vieux...
Comme un couple qui danse, entre les livres, le désir immobile du mot (« le mot désirait-il se soumettre à la rigueur d'un vers ? »), la phrase dans sa métamorphose de verset et les fantômes qui reviennent : « Vous, Guillermo Enrique Hudson, Argentin de naissance et par amour des oiseaux... » et l'autre, Esteban Echeverría (1805-1851) dont l'évocation donne envie de tout lire.
En version douce, le poème du souvenir devant ; en cruauté contrôlée, la méditation poétique sur l'Argentine. Un écrivain se reconnaît, au XXe siècle, à la totale absence d'emphase qu'il met à ruiner le fascisme, l'hypothèse même du fascisme : « Tant que tu vivras, il te faudra rêver ». La condition de ce genre nouveau qui va chercher dans le plus ancien, le portrait politique sans concept, c'est la poésie même. Le mot en deviendrait imprononçable ? Au point qu'un bateleur qui pestait, l'autre jour, contre le retard de Jacques Réda à la radio, se crut obligé de meubler en claironnant « le romancier Jacques Réda » ? Ou Kenneth White, qu'en note on répute « romancier écossais » ?
A quoi bon inviter Réda si l'on ne sait pas qu'il est tout sauf romancier ? Qu'est-ce qu'un temps qui a peur de ses poètes ? Comment nommer celui, Argentin par amour des oiseaux, Arnaldo Calveyra, qui se retire, livres faits de cette façon : « Ainsi moi, ministre sans portefeuille en voyage à l'étranger, près de m'approcher de vous avec ma lettre, comme étendu au milieu des marguerites sauvages dans un pré antérieur à la conscience, dans un surcroît de bonheur, je me penche à la fenêtre baignée d'aurore... »
La lettre remise : « Je m'exprime par paraboles, car il ne reste plus de temps. Et encore moins de mots. Bientôt, je ne serai plus dans cette pièce, bientôt nous ne serons plus ici. » C'est l'Argentine qui est un roman. Son narrateur, un poète. Soit un ministre vraiment sans portefeuille.
FRANCIS MARMANDE
source: www.lemonde.fr
Le Livre du miroir (édition bilingue)
de Arnaldo Calveyra (Auteur)
Broché: 135 pages
Editeur : Actes Sud; Édition : Ed. bilingue (16 mai 2000)
Collection : Poesie
En compagnie d'un miroir, le poète revisite les lieux et les temps de l'enfance. Le miroir n'est pas ici simple reflet : l'image qu'il renvoie remonte des tréfonds de l'âme, pour donner au souvenir une nouvelle existence avant de réfléchir une image retranscrite qui est poésie.
Dans un perpétuel retour au même contexte, Arnaldo Calveyra évoque dans une langue sobrement ouvrée le jardin "plus parfumé d'enfance que de jardin", et le "cœur du couchant enflammé pour toujours". Mais, par le jeu du miroir, ce recueil constitue également une très belle allégorie de la création poétique.
"Ecrire sur des soleils, les soleils d'un jardin, s'asseoir pour écrire un livre de poèmes à mesure que la lumière s'obstine à les rejoindre, à les écrire, et alors les soleils s'accumulent avant de se montrer, ils ne s'estiment pas arrivés, ils continuent à arriver sans cesse. Et que les soleils - qui seront, un jour, le jardin, le poème - entrent en jeu avec le reste des mots."
Maïs en grégorien
de Arnaldo Calveyra, Anne Picard (Traduction)
Broché: 122 pages
Editeur : Actes Sud (3 février 2003)
Collection : Un endroit où aller
Et moi, homme du pays d'Entre Rios, venu chercher une retraite silencieuse à l'abbaye de Solesmes, je m'assois dans un endroit reculé de l'église pour écouter le grégorien qui gonfle comme un champ de maïs de part et d'autres de la nef, pour atteindre les berceaux de la voûte tiédis par la lumière des cierges. J'écoute le moine à ma droite, debout contre une colonne, en quête de notes qui s'aiment
.A. C.
extrait:
Deux heures du matin. J’écoute la chanson inventée par un bègue. Son seul désir la met en marche, l’air se raréfie peu à peu. A cause de ce qu’elle est, de l’air, la chanson se raréfie, s’absorbe dans des voyelles tout juste venues à l’esprit, glisse entre les saintes qui s’inclinent doucement dans leurs niches en offrant le nard serré par leur main délicate. Sur toute sa longueur, sa largeur, sa hauteur, la nef de l’église est parcourue par des murmures de noms : elle murmure, écho du murmure des nouvelles. Et voici la chanson soudain intéressée, elle commence à désirer que quelque chose, quelqu’un dans l’enceinte, reste un trésor caché, un jardin secret.
A force d’entêtement, d’obstination, la chanson évolue dans l’espace de l’enceinte. Peu à peu l’enceinte et l’espace trouvent une assise, un lieu entre l’air et elle — déjà tout ensemble l’air et elle. Chanson aux voyelles extatiques, en même temps déclinées : temps entre la chanson et l’air. Elles trouvent ce qu’elles cherchent tout en continuant à se mouvoir.
A force de lente obstination, elle finit par s’enflammer, elle s’enflamme en montant des cordes vocales des moines. Peu à peu elle trouve une place, l’air — l’air et elle — chanson qui est temps, nous et mémoire, elle chante, chante pour elle-même. Elle trouve ce qu’elle cherche et continue d’évoluer entre les bancs. J’en devine les traces, je suis spectateur de ces traces, chanson inventée par un bègue.
Des ailes se déploient, traces de bégaiement entre les bancs, les allées. L’ondulation de la chanson revient. Lieu pour l’air et pour elle, chanson faite de lys qui se putréfient. Voyelle que l’on vient de proférer dans la nef de l’église où nous sommes réunis. La chanson continue d’évoluer parmi les saintes qui s’adossent au mur sitôt que nous les regardons. Voyelles bercées par quatre murs. Les chanteurs, les saintes, un nard glissé dans la main, un autre entre les lèvres.
Nous venons assister au spectacle autour d’un plat incandescent et d’une danse. Et moi, homme du pays d’Entre Ríos, venu chercher une retraite silencieuse à l’abbaye de Solesmes, je m’assois dans un endroit reculé de l’église pour écouter le grégorien qui gonfle comme un champ de maïs de part et d’autre de la nef, pour atteindre les berceaux de la voûte tiédis par la lumière des cierges. J’écoute le moine à ma droite, debout contre une colonne, en quête de notes qui s’aiment.
Auquel de ces deux fleuves le voyageur a-t-il prêté attention ? Lequel de ces deux fleuves a conversé avec la mer ? Quel est le fleuve virtuel et celui de l’esprit ? Le chant vacille-t-il quand l’imagination faiblit ? Homme sans âge, moi qui écris ces mots, ni grand, ni petit, sans signes particuliers, venu du pays d’entre deux fleuves, j’écoute la plainte du grégorien sans rives, je cherche dans les caissons du dôme la raison de mes envies de silence.
Maïs en grégorien qui ondoie, né des crêtes et des collines dans la mésopotamie argentine. On dirait la chanson inventée par un bègue, par la force de son désir il aurait fini par la mettre en marche dans l’enceinte d’une pièce vide : à présent, plus l’ombre d’un bégaiement. Le chant, libre, conserve les traces d’anciennes hésitations, la chanson, sans points d’appui, sans lignes précises, avec une mélancolie toute confiante, entre alors en relation avec lui. Tous deux s’amusent à se donner des noms, à échanger des horizons, des noms de musiques inconnues, l’air alentour trouve alors une assise, un lieu pour l’air — tout autour temps et chanson. Chanson laissée pour morte dans les collines près des côtes de l’Uruguay et sortant à présent de la bouche de quelques moines.
Quelles cordes vocales pourront retenir cette chanson avant qu’elle disparaisse ou se perde ? Une voyelle à froid commence à s’enflammer — enclose, indifférente, détachée. Entre elle et nous il ne reste plus d’air. Une seconde voyelle se propage en direction des saintes postées dans leurs niches de verre. La nef de l’église parcourue de noms paraît haute, haute, large. Elle trouve un lieu pour l’air et pour elle — lieu qui est tout ensemble l’air et elle —, une voyelle extatique chante, chant et temps entre elle et nous, chanson qui est temps, nous et mémoire. Elle chante, chante pour elle-même. Ange transi sur la droite. La voyelle anesthésiée s’écarte du mur.
A présent que la lumière des cierges décrit mon silence, par rangées, par rafales, le grégorien gonfle comme le maïs, anabase en noir et blanc, il monte et redescend d’un ciel. Je sors mon cahier et commence à écrire le livre qui s’esquisse à peine.
Miroir avançant avec la mort, caché par Salomé qui surgit par-derrière. Instants du regard du prophète. Caché par Salomé, miroir retourné, les yeux du prophète sont devenus aveugles, des yeux où toute image est désormais insoutenable.
Lentement, l’épi monte de la racine. Les couchants dérobent la vue. J’observe le rideau de l’eau dormante. Lieu : l’air. "N’oublie pas l’hospitalité." Chanson au cœur sec. Impossible image.
Sous cette même pluie un homme muet. La contemplation de la pluie le rend plus silencieux encore. La pluie entre par le rai de lumière d’une porte qui s’ouvre, grâce à cette lumière elle gagne le patio et l’homme croit avancer dans une lumière mouillée, homme d’une seule pluie. Pèlerin en quête de silence, si cette porte était plus proche et s’il ne faisait pas nuit, tu assisterais au retour de l’enfant prodigue. Immobile à l’entrée de son terrier, un lièvre de la pampa sort l’aube de son sommeil.
Transpercé par cette pluie qui lui vient du passé, à mesure qu’il s’enfonce en souvenir vers ces lieux, il s’enfonce dans un passé de pluie. Homme que la contemplation de la pluie rend silencieux, le ciel, un robinet cassé : enterrement de Mozart. Pluie silencieuse, la terre fait silence, l’homme regarde les arbres s’éloigner puis disparaître.
Il reste sous cette pluie prévenante. Homme que sa lumière, silencieuse lumière, rend silencieux, et en qui les souvenirs se font pluie. A peine se détourne-t-il pour éviter les branches tombées. Il regarde les arbres se rapprocher. Silencieuse la pluie, silencieux l’homme qui s’enfonce en elle, pluie de mémoire qui le mouille.
Il pleut, la pluie aveugle arrivant du fond des terres transperce l’homme qui marche. Poussé par ses propres nuages, homme à moitié nuage, il avance tranquillement. Quels nuages peuvent bien être ces nuages ? Quels oiseaux se cachent derrière ? Horizon des cimes de la pluie.
Horizon des cimes de la pluie, dévasté par la frondaison du déluge sous lequel il avance, il vient du passé de cette pluie, toujours la même. L’homme reste à la porte de sa cabane tout en marchant dans la campagne.
Lumière de pluie à Entre Ríos. Pour l’homme immobile à la porte de sa cabane elle vient de naguère, les plantes l’accueillent avec joie, petite flamme toute tremblante qui déjà grandit, à peine sortie de terre, le cheval vire au bleu dans cette lumière spongieuse. L’homme s’approche de la clôture pour la saluer et Entre Ríos n’est plus que pluie, une pluie unique. Il semble se pencher un peu au bord des flaques. L’horizon n’en finit pas.
Il pleut des lustres (sur la monnaie d’autrefois). Le passé revient avec la pluie. Mot lointain avec elle se fait jour. Les années sont d’ici et de nulle part. La distance apparaît disparaît comme dans un mirage.
Défilé des années. L’horizon d’eau. Bleu du cheval immobile au milieu de la campagne. Le regard se liquéfie, il liquéfie les airées et les silhouettes dans le lointain. Pluie, tu redoubles en atteignant l’horizon, joues-tu à perce-ciel ?
Lumière de pluie à Entre Ríos, que les roselières près du puits soient bleues. Lumière de pluie à Entre Ríos, les roselières près du puits rêvent en bleu. Pluie voisine des fleuves, proche des berges du marais. Bleu du cheval dans le ciel assombri. Le passé se rapproche encore un peu, il rêve en bleu, il rêve d’un cheval de couleur bleue.
L’homme sort de la cabane pour contempler les nuages. Dans les herbages, les premières grosses gouttes, petits coups mollement frappés, homme éveillé par sa propre pluie. Dieu fait de chair d’homme, homme seul dans la campagne enténébrée du matin. Il avance au milieu des térous qui s’abritent dans les prés, la perdrix est devenue perdrix, il avance dans la pluie comme un animal dans les galeries de son terrier. Il avance à la manière d’un homme. Silencieuse la pluie, silencieuse la terre. Homme qui semble appeler le silence.
De ces nuages naissent des nuages, quels oiseaux prennent la fuite ? A qui peut servir cette lanterne restée accrochée au toit ? Devant l’horizon sans fin, entre les nuages spongieux qui se baissent, pluie capable d’apaiser le feu des corps. Petite hutte de fournier, en ruine semble-t-il, abandonnée semble-t-il, un cassier la tient debout.
La pluie le suit comme un chien, elle avance avec lui, l’accompagne. Ils sont tout ensemble hauteur largeur, la même chose. Le matin n’est nulle part. Ciel chargé, bouché. Silencieux sous cette même pluie, un homme, presque le même avec la pluie de naguère. Il est en train de devenir pluie.
Assis dans l’église, fatigué par le long voyage, d’où vient cette lamentation qui s’achève en silence ? Silence qui est et restera mien. Petit homme du pays d’entre les fleuves, pour devenir un recoin d’église, reste dans le recoin de l’église.
Derrière les portes, l’épi aux grains blonds métissés que l’on vient de cueillir est placé sur un plat blanc étincelant. Eclats insistants de l’ampoule, lumière oubliée au fond du chœur, voyelle empruntée aux saintes. La tête du prophète assaillie par le doute. La blancheur paraît la protéger et l’aveugler à la fois. L’aveugler davantage.
source: www.actes-sud
Livre des papillons : Edition bilingue français-espagnol, Libro de las mariposas
de Arnaldo Calveyra, Anne Picard (Traduction)
Broché: 156 pages
Editeur : Le Temps Qu'il Fait (8 octobre 2004)
Composée en 1962, cette suite de poèmes a été publiée en Argentine en 2001. La disparition maternelle, en suspens ou pressentie dans Lettres pour que la joie, devient ici réalité. Souvent concentrée sur des choses simples, des choses d'ici, la poésie d'Arnaldo Calveyra a la palette douce des toiles de Giorgio Morandi. Comme le peintre, le poète fraye un passage singulier à la lumière et nous fait entrevoir la lueur du monde sur fond de nuit. Une conscience très aiguë de la finitude et de la mort affleure, avec, au final, quelque chose de prodigieusement calme. Un voile semble déposé sur les lieux et les êtres, et l'on songe au mot pudeur.
Né en Argentine en 1929, Arnaldo Calveyra vit en France depuis 1961. Poète, romancier et dramaturge, il a publié ses premiers textes traduits en français dans Les Lettres Nouvelles en 1972 et la N.R.F. en 1980. Parmi ses publications en France : Lettres pour que la joie (Actes Sud, 1983) Le lit d'Aurélia (id., 1989), Antbologie personnelle (id., 1994), L'homme du Luxembourg (id., 1998) et Maïs en grégorien (id., 2003).
|
Journal d'Eleusis (Broché)
de Arnaldo Calveyra (Auteur)
roché Editeur : Actes Sud (2 avril 2008)
Collection : Un endroit où aller
Des heures qui se visitent, comme des pèlerins qui reviennent au point de départ. Lumières erratiques dans un moment de jardin, dès les premières heures des images pour cette fable et des voyelles qui les décrivent. Pour que tes pas, faits de prières, puissent s'entendre dans le jardin d'alors, reviens au point de départ au milieu des herbes folles qui prolifèrent.Ecoute, en attendant, les fleurs : au cœur du petit matin possible, des images de la rosée qui ne s'adressent pas aux yeux. Décris, décris les fleurs, ce jardin.Que tes pas puissent se laisser entendre à Eleusis, jardin dans le matin. Comme nous entendons cet oiseau près du porche d'entrée.
A. C.Poète, dramaturge et romancier, Arnaldo Calveyra a publié l'essentiel de son oeuvre chez Actes Sud et aux éditions Le Temps qu 'il fait. Il vit à Paris depuis les années 1960.
|
|
Calendrier
Juin 2009
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|


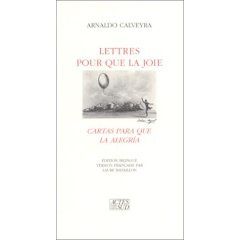
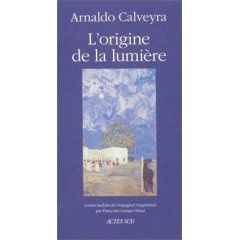


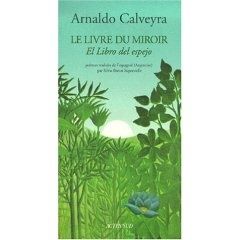



Derniers commentaires
→ plus de commentaires