
Alejandra PIZARNIK
présentation des écrivains argentins traduits en français
 Alejandra PIZARNIK [ARGENTINE] (Buenos Aires, 1936 — Buenos Aires, 1972). Elle s'impose très jeune dans la poésie de son pays par ses recueils La tierra más ajena (1955), suivi de La última inocencia (1956) et de Las aventuras perdidas (1958). Après des études de lettres et de peinture, elle s'installe à Paris en 1960 et s'y lie avec André Pieyre de Mandiargues, Octavio Paz, Julio Cortázar. Elle travaille comme correctrice d'épreuves pour la revue de langue espagnole Cuadernos, traduit Hölderlin, Artaud et Michaux et publie quelques textes dans des revues françaises ainsi que le recueil Arbol de Diana (1962). Rentrée en Argentine, « elle exprime sa solitude et ses angoisse devant la vie » dans Los trabajos y las noches (1965) et Extracción de la piedra de locura (1968). En 1969, une bourse de la fondation Guggenheim lui permet de séjourner aux États-Unis et d'écrire un essai sur Erzebeth Báthory (La Condesa sangrieta). « Un mal de vivre inexorable qu'elle semblait vouloir exorciser par la beauté de l'écriture » (Claude Couffon) lui dicta encore avant de se suicider : Nombres y figuras (1969), El infierno musical (1971), Los pequeños cantos (1971). En 1982 a été publié son recueil posthume Textos de la sombra y Últimos poemas.« On revient perpétuellement au combat acharné avec les mots et leur signification qui sont pour Alejandra Pizarnik la parole introuvable, et perpétuellement à cette solitude absolue à partir de laquelle on parle sans parvenir à se dire. Parfois en deux lignes, elle cerne, constate l'impossibilité de s'exprimer, de trouver. On dirait que le secret se cache dans les mots, le secret de la vie, et que c'est là, et nulle part ailleurs où il y aurait une chance de découvrir le mystère, de connaître la paix, de voir surgir un dieu. » (Silvia Baron Supervielle, 1986).
A propos de la comtesse sanglante
de Alejandra Pizarnik (Auteur), Jacques Ancet (Traduction) 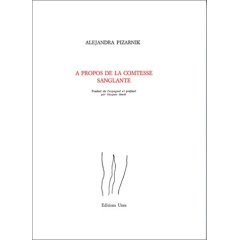 Broché: 42 pages
Editeur : Editions Unes (décembre 1999) A propos de la comtesse sanglante (traduit de l'espagnol et préfacé par Jacques Ancet) Oui, Jacques Ancet a raison. Il convient de prévenir le lecteur. A propos de la comtesse sanglante d'Alejandra Pizarnik vaut par lui-même et pour ce qu'il nous apprend des hantises qui traversent sa poésie, peu traduite encore en France, notamment celle de la mort. A quoi je rajouterai volontiers qu'il a cette qualité de présence qu'ont les écrits qui s'arrachent tout saignant de la vie et dont "chaque mot dit ce qu'il dit et plus encore et autre chose aussi".D'Alejandra Pizarnik on ne saurait dire telle vie, telle œuvre comme on le dit souvent mais bien telle œuvre, telle mort. Alejandra Pizarnik rejoignit ses poèmes le 25 septembre 1972. Son sang la noya. A moins que ce ne soit le seconal qui le glaça.Le sang ! Celui qui brille dans tant de nos expressions ! Sang de la vie et de la mort.Erzsébet Bathory ne pouvait que fasciner Alejandra Pizarnik.La comtesse - ses "dents de loup" - et ses quelques 600 victimes. Toutes des jeunes filles. Toutes torturées. Toutes saignées. La comtesse et sa hantise de la mort. Du vieillir. La comtesse qui se baignait dans le sang des vierges pour rester jeune et belle . La comtesse et "la beauté convulsive" de son combat. De son affrontement à l'impossible : "nul jamais ne voulut à ce point ne pas vieillir, c'est-à-dire mourir. C'est pourquoi elle représentait et incarnait peut-être la mort ; Car, comment la mort pourrait-elle mourir ?". La comtesse et son silence : "assise sur son trône" et qui "regarde torturer et écouter crier". La comtesse et son miroir, habitante du pays froid des reflets. La comtesse et sa mélancolie, ce mal du XVIème siècle.Alejandra Pizarnik pouvait-elle ne pas s'identifier à la comtesse ? Entendons-nous. L'une tue pour se maintenir en vie, l'autre écrit pour la même raison. L'une croit dans les vertus régénératrices du sang humain, l'autre se fait un sang d'encre. Les deux occupent la place de la mort. Si elle est "la Dame qui ravage et dévaste tout comme et où elle veut" quand elle prend les traits de la "Dame des ruines", elle est celle qui "(dit) un mot sans jamais cesser" de ne pas le dire, celle qui interdit aux "mains de poupées" d'Alejandra Pizarnik de se mêler aux "touches" et d'entrer "dans le clavier pour entrer dans la musique et pour avoir une patrie".Alejandra Pizarnik restera donc parmi nous. Noir sur blanc. Présente dans les pages qui accueilleront ses écrits, leur amour sans fin du silence et du "langage des corps". © http://www.chantiers.org/ Oeuvre poétique de Alejandra Pizarnik
Silvia Baron Supervielle (Traduction), Claude Couffon (Traduction) 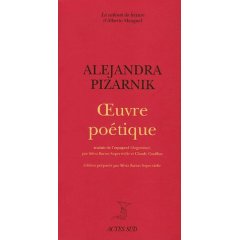 Broché: 341 pages
Editeur : Actes Sud (10 novembre 2005) Collection : Le cabinet de lecture " Alejandra habitait un appartement minuscule au cœur de Buenos Aires. [...] Près de son bureau, elle avait épinglé une phrase d'Artaud : " Il fallait d'abord avoir envie de vivre. " La chambre était sobrement meublée : le bureau, un lit, quelques livres et un petit tableau noir sur lequel elle ébauchait ses poèmes, à la façon d'un sculpteur, entaillant à petits coups un bloc qu'elle savait receler quelques mots essentiels et précieux. Tout son art consistait à parvenir à ce noyau caché au cœur d'une masse complexe de pensées, d'images et d'intuitions, en décomposant un argument poétique afin d'en atteindre le dénominateur fondamental. Elle écrivait des phrases au tableau et puis, jour après jour (ou nuit après nuit de veille), elle effaçait un mot après l'autre, en remplaçait certains, en supprimait d'autres jusqu'à ce que finalement, au prix d un effort physique considérable, elle laissât subsister quelques vers, durs et étincelants comme des diamants, qu'elle copiait alors dans ses carnets de son écriture minuscule et régulière d'écolière. Ecrire, c'est donner un sens à la souffrance, notait-elle dans son journal en novembre 1971. [...] Dans son journal, le 30 octobre 1962, après avoir cité Don Quichotte (Mais ce qui fit le plus plaisir à Don Quichotte fut le silence merveilleux qui régnait dans toute la maison... "), elle a écrit : Ne pas oublier de me suicider. " Le 25 septembre 1972, elle s'en est souvenue." Alberto Manguel (extrait de la postface) Alejandra Pizarnik, Journaux, 1959-1971.
Collection Ibériques, Corti, 2010.  Depuis les années 50 jusqu’à son suicide, en 1972, Alejandra Pizarnik n’a eu de cesse de se forger une voix propre. Conjointement à ses écrits en prose et à ses poèmes, le journal intime qu’elle tient de 1954 à 1972 participe de cette quête. Une voix creuse, se creuse, avant de disparaître : « Ne pas oublier de se suicider. Ou trouver au moins une manière de se défaire du je, une manière de ne pas souffrir. De ne pas sentir. De ne pas sentir surtout » note-t-elle le 30 novembre 1962.
Le journal d’Alejandra Pizarnik se présente comme une chronique des jours hybride, qui offre à son auteur une sorte de laboratoire poétique, un lieu où s’exprime une multiplicité de « je », à travers un jeu spéculaire. Au fil des remarques d’A. Pizarnik sur sa création, sur ses lectures, de ses observations au prisme des journaux d’autres écrivains (Woolf, Mansfield, Kafka, Pavese, Green, etc.), une réflexion métalittéraire s’élabore, lui permettant un examen de ses propres mécanismes et procédés d’écriture. Le journal est aussi pour Alejandra Pizarnik une manière de pallier sa solitude et ses angoisses : il a indéniablement une fonction thérapeutique. « Écrire c’est donner un sens à la souffrance » note-t-elle en 1971. Alejandra Pizarnik utilise ainsi ses cahiers comme procédé analytique, refuge contre la stérilité poétique, laboratoire des perceptions, catalyseur des désirs ou exutoire à ses obsessions. Les Journaux sont toutefois moins une confession ou un récit de soi qu’un ancrage mémoriel, une matière d’essayer de se rattacher au réel par des détails infimes et de se rappeler qui l’on est.
|
Calendrier
Recherche d'articlesArchives par mois
liens amis
|
Derniers commentaires
→ plus de commentaires