L'origine de la lumière
de Arnaldo Calveyra (Auteur)
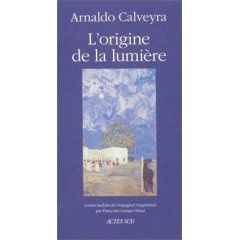
Broché: 153 pages
Editeur : Actes Sud (10 août 1993)
Collection : Lettres latino-américaines
Onze contes poétiques qui participent de la vision enfantine avec les sensations et les angoisses qui hésitent entre le rêve et le réel.
Extrait de L’origine de la lumière:
Arnaldo CALVEYRA L'origine de la lumière
Dans l’année, il y avait un jour — c’était une date mobile qui s’amusait à se déplacer d’une semaine ou deux — un jour que l’on appelait le jour de l’ouragan ; et c’est en pleine connaissance de cause qu’on le nommait ainsi car il faisait partie de l’héritage laissé à la mort de quelqu’un au même titre que les casseroles, les bouilloires, les chaises ou les chiens de la maison. Certains allaient même jusqu’à évoquer des événements personnels, deuils, mariages, paiement d’une dette, perte d’un troupeau de chevaux, etc., en le prenant comme point de repère chronologique. Du coup, le jour de l’ouragan rivalisait avec l’avènement du Christ.
Il pouvait, je l’ai dit, être en retard ou en avance mais, comme un cheval encore sauvage que l’on oblige à se mettre en piste avant le début de la course, nous le savions à l’affût dès qu’approchaient les fêtes de fin d’année, et s’emplissant peu à peu de la terrible force qu’il déchaînerait en son temps. Son travail sournois, nous le sentions dans nos corps déliquescents qui, avant d’entreprendre la moindre tâche, cherchaient à s’affaler sur le premier siège venu.
Certains oiseaux, ces jours-là, alertés par l’imminence d’on ne sait quel événement extraordinaire, cessaient de fréquenter le ciel de la maison et s’en allaient chercher refuge en des lieux ignorés de nous. Pourtant, fait qui jamais ne se répéta, à la veille d’une de ces tempêtes apparut un pigeon voyageur. Epuisé, petit astre blanc tout fiévreux, il vint se poser dans un des patios. Les premiers secours ne tardèrent pas à s’organiser. Il avait une bague à la patte, qui cachait probablement un message. Nous lui donnâmes à boire et laissâmes quelques graines à sa portée. Nous nous disions que le tremblement de ses ailes, cette fièvre l’achèveraient, et nous l’installâmes dans un endroit frais, hors d’atteinte de la curiosité des chiens. Trois ou quatre jours passèrent. Environné par une fraîcheur de ruisseau, le pigeon survécut. Il recommença à s’alimenter et le lendemain de l’ouragan réussit à reprendre son vol.
Autre signe précurseur : la netteté persistante qui gagnait la rondeur du ciel et tout ce qui s’y reflétait : maisons, branches, végétation. Immuable, imperturbable, l’ouragan s’emparait de l’horizon, s’y installait, s’y maintenait, y durait. Sans parler des animaux qui recherchaient le moindre recoin d’ombre, le plus léger soupçon de feuillage.
L’ouragan dont je me souviens nous avait envoyé des signes avant-coureurs grâce au très délicat ouvrage d’une araignée, une toile qui s’obstinait depuis plusieurs semaines dans sa perfection et dont, chaque matin au lever, nous pouvions admirer la splendeur encore chargée de deux ou trois gouttes de rosée luisant au soleil. Fierté d’un des casuarinas de l’entrée, cette toile, mystérieusement, fut détruite. Enfin, indice encore plus digne de foi : ce soir-là, à la nuit tombante, l’horizon ne fut pas touché par l’ombre, la lumière ne se modifia pas, ne s’éteignit pas, ne l’abandonna que très tard.
Nous le guettions depuis une bonne semaine. Mais à force de l’attendre et de le voir chaque fois se dissiper à l’horizon, nous finîmes par acquérir la certitude qu’il nous trouverait, comme presque tous les ans, endormis… un ouragan qui abattit des arbres, démolit des moulins, déchiqueta le bétail, démantela granges et silos ; le four à pain lui-même, si protégé, si oublié dans son petit creux de paradis, se vit forcé de sacrifier quelques-unes de ses briques à ce dieu sans foi ni loi.
Notre corps, cet assemblage d’eau et d’âme, pesait des tonnes sous nos vêtements et les travaux que nous dûmes entreprendre cet après-midi-là nous semblèrent dignes d’Hercule ; nous courions aussi vite que possible d’une ombre à l’autre ; le bouclier de nos chapeaux s’avérait impuissant à nous protéger des tenailles incandescentes du soleil ; les mouiller en passant devant un robinet s’avérait inutile, il nous fallait chaque fois inventer une nouvelle stratégie pour regagner bien vite les endroits où il y avait de l’ombre : mur, arbre, treille, avec toujours la même envie de défier ce soleil qui se prenait tellement au sérieux.
L’été, il nous arrivait, l’après-midi, d’attendre avec nos éventails — cadeaux de fin d’année des commerçants du bourg, ornés de photos d’actrices ou d’acteurs de cinéma nord-américains —, que la chaleur veuille bien céder, ne serait-ce que de quelques pouces. Mais ce jour-là, ce fut en vain que nous guettâmes le plus léger des signaux, l’apparition d’une brise, si modeste fût-elle ou une preuve plus ou moins manifeste de la fusion du jour dans la nuit. Nous ressemblions à des comédiens épuisés sur une scène que l’éclairagiste aurait quittée en oubliant d’éteindre les projecteurs.
Dans cette obscurité qui n’en finissait pas de s’installer, nous pouvions entendre, au-dessus de nos têtes, l’agitation erratique des oiseaux, leurs déplacements de branche en branche ; ils se chamaillaient, aussi déroutés que nous en bas, insomnieux dans la profondeur plus ou moins retrouvée du patio ; et puis, de nouveau un froissement d’ailes, un abri que l’on abandonnait, le besoin de partir à la recherche d’un buisson lointain.
Enfin, quelque chose que l’on pourrait assimiler aux prémices d’un crépuscule commença à rôder autour de nous, à cerner nos masques blafards.
Devant l’absence de brise amicale, dans cette fixité torride qui semblait nous renvoyer à une lueur de lever du jour, nous allâmes nous asseoir sous la tonnelle pour le dîner. Il y avait, je crois, des gens de Buenos Aires. J’ai oublié leur conversation, tout emplie sans doute de points de suspension. Subitement, au milieu d’un silence de plomb, nous perçûmes nettement que les cimes des casuarinas se mettaient à l’écoute, tendues, comme à l’affût d’un brusque déplacement de troupeaux là-bas, avant d’entrer presque aussitôt en un jeu désespéré de questions et de réponses, un jeu apparemment sans issue, à en juger par sa mise en route circonspecte.
Ce fut d’abord comme si des centaines d’oiseaux se réveillaient sur ces branches qui, brusquement, nous parurent étrangères, ou comme si oiseaux et branches, sur la défensive et pour tenter de conjurer un malheur en suspens dans l’air, perdaient d’un coup toute identité. Car déjà ils s’essayaient à un chant qui, à l’évidence, leur était totalement inconnu (à moins que la terreur, et la terreur seule, ne les aidât à trouver la note suivante de cette lugubre mélodie). Mais nous, nous savions que cette chanson ressemblait, autant qu’une goutte d’eau à une autre, au prélude de l’ouragan de l’année précédente, un ouragan, soit dit en passant, qui planait maintenant au-dessus de nos têtes.
L’espace entre les casuarinas fut occupé par un sifflement aussi aigu que le rugissement d’une cataracte gigantesque qui se serait précipitée de hauteurs jamais imaginées par aucun conquistador. Ce sifflement, bien que nulle mémoire ne l’eût jamais enregistré, semblait vouloir attirer — tel un faucon lanier au fin fond des fourrés — des oiseaux que nous n’avions jamais vus, tandis que ceux qui s’estompaient au-dessus de nos têtes s’employaient, en une basse continue, à narguer la masse que formait la nuit et que ce bramement nous chassait de nos sièges, gagnait en fureur et se déplaçait le long d’une falaise qui n’était autre — nous nous en rendions enfin compte — que les frondaisons des arbres.
Il arrivait en tourbillonnant, et de si loin que personne n’aurait pu lui poser la moindre question. Après que le premier coup de fouet eut lacéré le ciel, vint le tour de la tonnelle qui parut entrer dans le poing d’un géant, s’agita, se secoua, comme si, dans la confusion générale, quelqu’un l’avait prise pour un poirier chargé de fruits mûrs, ou comme si l’on cherchait à l’arracher du sol, elle, les piquets, les plantes, les clous, les grillages, et nous avec, tandis que le premier tremblement de terre s’attardait entre nos bras et que les assiettes se couvraient de pétales de roses — les roses préférées de tante Adelina, que l’on appelait les sept sœurs — et qui cette nuit seraient le mets de prédilection du vent.
La rafale de vent — le vent dans toute son ampleur, tous les vents à la fois — prenait à présent une consistance liquide, montait de plus en plus au-dessus de nos têtes, englobait la masse entremêlée des arbres et continuait à s’élever en tire-bouchon, jusqu’à s’emparer du ciel tout entier.
C’est alors qu’un lambeau de ce vent sembla se détacher des grands eucalyptus du jardin, perdre momentanément de sa vitesse et se retrouver, vibrant, entre nos bras, qu’il força à décrire d’incohérents signaux dans le vide.
La tornade cependant continuait à ramasser tout ce qu’elle trouvait sur son passage. Dans la panique, les lanternes avaient été rentrées, toutes les lampes précipitamment éteintes afin d’éviter les incendies ; une voix féminine (tante Adelina, ma mère ou l’une de mes sœurs ?) nous appelait de l’intérieur, pour nous soustraire aux éléments, au lieu sans frontière où nous nous attardions, tandis que déjà la roue du moulin, libérée de son frein, tournait comme une folle et s’engageait dans une course contre le cyclone. Les arbres les plus éloignés de la maison, ceux qui nous servaient de lien avec la vastitude des champs, étaient passés de la pleine terre à la pleine mer.
Et comme quelqu’un que l’on croit simplement ivre mais qui devient fou au milieu de la nuit, cet abysse était en vérité fou lui aussi, lame déferlant sur le bétail pour le sortir de sa torpeur, déplaçant les chevaux dans les prés comme s’ils étaient pourvus d’ailes, oui, et fous les vents (combien pouvait-il y en avoir ?) qu’il renfermait sans doute dans ses profondeurs et qui pouvaient maintenant tout renverser sur leur passage, nous entraînant au fond des eaux pour nous faire goûter de leur terrifiant prestige.
Enfin, comme une farce soigneusement préparée pour l’heure du dîner mais trop tôt dévoilée, le vent, dont l’intensité semblait avoir décru, fit un petit tour avant de revenir, métamorphosé en ouragan, tandis que la nuit s’emparait du patio tout entier.
Malgré les appels pressants des femmes, c’était merveilleux — ce le serait aujourd’hui encore — de rester dehors, les bras chargés de tempête, de rester dans le noir absolu, dans l’exubérance de la tourmente, devant ce seuil inconnu tout empli de tumulte et traversé seulement par quelques éclairs dont la tâche visible était d’amener la pluie ; de respirer l’odeur que prenait la terre cernée par une unique pensée, par un événement digne d’être relaté, alors qu’il n’y avait plus trace de la moindre lanterne, et que les fenêtres, fermées depuis longtemps, faisaient stoïquement front à l’attaque furieuse, oui, merveilleux d’être dehors jusqu’à ce que surviennent les grondements de tonnerre et qu’en se perdant au loin ils annoncent les premières gouttes de la pluie tant attendue qui, en un tournemain, inondait les conduites d’eau et semblait surgie de terre plutôt que tombée du ciel.
© http://www.actes-sud.fr/

Derniers commentaires
→ plus de commentaires